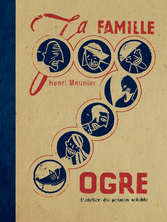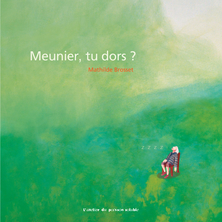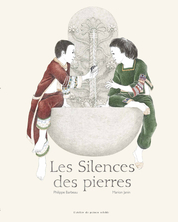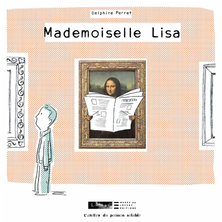Extrait du livre En être ou pas
En être ou pas De Pierre Leterrier Aux éditions L'atelier du poisson soluble
En être ou pas
Autant pour elle
Elle prétendait les avoir inventées pour lui. Vilmon la croyait. Plus tard il comprit qu’il était prétentieux d’imaginer les notes négatives conçues uniquement pour sanctionner ses fautes d’orthographe, même si, cette année qui précéda son entrée en sixième, il en avait été le seul bénéficiaire. Son institutrice, femme de principes, aussi sévère qu’équitable, jugeait anormal d’attribuer un zéro identique, lisse, rond, quasi bonhomme aux cinq fautes d’une dictée et aux cinquante d’une autre : la sienne. Elle exagérait ? Un peu, mais elle avait su également l’inscrire au tableau d’honneur un jour où il n’en avait commis qu’une demi-douzaine. Afin de mettre un terme au début d’hilarité collective que cette mesure d’extrême clémence (ou d’indulgente ironie ?) avait provoqué, elle avait précisé que ce n’était pas la performance orthographique encore pitoyable de Vilmon qui justifiait cette prestigieuse distinction, seulement son effort dont l’immédiat petit éloge — digne d’un sous-préfet IIIe République à l’occasion d’une remise
de certificat d’études dans un canton rural — avait fait souffler le vent du passé sur ce coin de banlieue. De surcroît, avait poursuivi l’enseignante, était ainsi compensée une injustice : sa mauvaise orthographe pénalisait Vilmon dans tous les travaux écrits, où il obtenait cependant des notes honorables, supérieures en tout cas à celles de bien des rieurs qui, à l’abri d’une orthographe très moyenne, croyaient habile de se contenter de résultats à peine passables et de ne témoigner qu’un médiocre intérêt pour ce qu’on tentait de leur apprendre. Fixant alors quelques élèves de son œil noir où se concentrait le plus beau de son feu méridional, elle avait rétabli le silence… et la position de Vilmon dans la classe. Il n’était pas le cancre ou l’idiot que certaines scènes suggéraient. Celle en particulier où, voulant lui faire comprendre la différence entre accents aigus et graves, n elle lui avait ordonné d’écrire au tableau le mot élève et, constatant que là aussi, là encore il hésitait, elle lui avait pris la main puis, clamant « é-è, é-è, é-è, é-è, é-è »… au rythme croissant de son exaspération, lui avait fait tracer une double colonne des accents correspondants, jusqu’à ce que la craie se brise. Il avait ri, parce qu’il se savait ridicule mais aussi parce que le tableau, sous l’assaut de ces inflexions diacritiques si blanches, si courbes, si fortement pleines en leur début, si joliment déliées sur leur fin, à l’image de virgules aériennes, avait évoqué un bord de mer où auraient dérivé une nuée de tout petits voiliers mis en ligne par un vent débonnaire et joueur. Ne connaissant pas le poème (accent grave) de Paul Valéry (accent aigu) où de semblables voiles sont dites « colombes sur un toit tranquille », il ne pouvait y penser. Pourtant quelque chose du scintillement de l’onde au soleil était là. Surtout que la maîtresse avait vraiment un air du Sud. Dès lors le mot élève fut un minuscule bateau dont la voilure à gauche, à droite, accordait enfin une sonorité fixe aux deux accents qui, cessant d’être des pièges maléfiques, devinrent une invitation au voyage. Peut-être aussi avait-il, malgré la dureté du ton, la rudesse du mouvement, trouvé doux le contact de cette main féminine si brune couvrant la sienne. Ce jour-là, il fut renvoyé à sa place avec colère mais sans brusquerie, et personne n’eut l’idée de le surnommer Accent Obtus afin d’immortaliser cet instant. Parnet, le premier de la classe, essaya un jeu de mots plus classique en substituant un c au m de son nom. Sans succès. Il renonça. Il n’était pas aimé et Vilmon, plus que l’hostilité, suscitait l’indifférence. Au pire la méfiance. Une orthographe à ce point en vrac était-elle contagieuse ? Il ne s’en plaignait pas, ne désirant pas plus que ça s’intégrer. Échoué dans cette école à la fin de l’année scolaire précédente, il ne s’habituait pas à son gigantisme : située aux confins de trois cités HLM surpeuplées, elle en accueillait tous les garçons.
Les entrées, les sorties n’étaient que bousculades de centaines d’écoliers hurlants, transformés en horde galopante dès l’ouverture des grilles ; les préaux, les toilettes, la cour de récréation, que foire d’empoigne jusqu’à la sonnerie qui, brusquement, immobilisait les élèves. Alors dans le silence soudain, silence porté par la clameur qui l’avait précédé et dont il était encore vibrant, silence qui durait, durait — afin que chacun prenne conscience de la transcendance du règlement à l’origine de cet arrêt sur image d’enfants ordinairement intenables ? Dans ce silence de film, figé sur un mouvement interrompu figurant une fin du monde, retentissait le coup de sifflet de monsieur le Directeur, long signal strident qui enjoignait aux élèves ranimés de se diriger sans mot dire, sans bousculade vers les bandes blanches peintes au sol pour indiquer où former les rangs. Maîtres et maîtresses, postés là, ordonnaient « Prenez vos marques ! » à leurs élèves, qui alors se mettaient en colonne par deux et tendaient le bras droit jusqu’à toucher l’épaule du précédent, ceux de la rangée de droite devant en sus lever l’autre bras pour toucher l’épaule du voisin. Et l’on restait ainsi, immobiles, jusqu’à ce qu’un sonore « Repos ! » autorise chacun à baisser les bras en se fouettant les flancs. Si le claquement n’avait pas retenti avec un bel ensemble ou avait manqué de conviction, si les rangs étaient sinueux ou perturbés par un regain d’agitation, le maître, la maîtresse criait : « Au temps pour moi ! » La première fois, Vilmon comprit Autant pour moi ! et crut, en son insondable innocence enfantine, que l’adulte, reconnaissant par cette formule alambiquée avoir commis une erreur dans l’énoncé des consignes ou manqué d’attention lorsque les élèves y avaient obéi, déclarait qu’il allait à son tour se livrer à la pantomime : il allait en faire autant. Ce ne fut pas le cas. Au contraire, sans attendre un nouvel ordre, les élèves répétèrent la manœuvre. Vilmon en conclut que, dans ce monde de brutes illustré un peu plus tôt par la cour de récréation, il assistait à un rituel, une sorte d’épiphanie merveilleuse de l’indulgence, de la générosité, de la courtoisie : la maîtresse ayant fauté et l’avouant humblement par son « autant pour moi », les élèves sans la moindre hésitation s’y collaient à nouveau, en jeunes mais résolus chevaliers servants heureux d’en faire (d’en refaire) autant, cette fois pour elle. C’était beau ! Après ce moment magique d’hallucinante galanterie surannée, la gente dame suivie de son escorte de pages aspirants-chevaliers, parfois dépenaillés, souvent d’une propreté douteuse, n’avait plus qu’à gravir aussi gravement que gracieusement les escaliers menant aux salles de classe. Cet autant / au temps pour moi fut-il l’occasion du premier échange entre Vilmon et Michel ? Ce dernier, fier de son savoir, expliquant comment ça s’écrivait, d’où ça venait, ce que ça signifiait : revenir au temps, c’est-à-dire à l’instant précédent afin de recommencer le mouvement
ordonné. Et, pour rendre incontestable son explication, il se serait réclamé de son père. Militaire. En Afrique. Vilmon aurait alors parlé de son grand-père maternel. Militaire lui aussi au début de sa vie d’adulte. En Afrique également ? Sans en être absolument certain, Vilmon pouvait le supposer presque sans risque puisque ledit grand-père — né grec — s’était fait légionnaire afin de devenir français puis, rendu à la vie civile, était devenu receveur des postes au Sénégal. En Casamance, un mot, un nom dans lequel Vilmon croyait entendre le flot puissant et pourtant doux d’un fleuve immense de méandres, de marigots, d’anses enflammées par des couchers de soleil sang et or à l’heure où les fauves vont boire avant de s’éloigner en grondant — lent rugissement de satisfaction qui dit la trêve des savanes. Est-ce ce dont Michel et lui parlèrent la première fois, éblouis par ce qu’ils imaginaient d’un soleil africain et par l’idée de cette loi qui sans un mot, sans un écrit, sans menace ni coup de sifflet, impose pour un instant calme, silence et paix à tous autour des points d’eau le soir venant dans les savanes et les jungles ? Règlement immanent qui, parce qu’il leur donnait une émouvante intuition de quelque secret qui échappe, valorisait celui de monsieur le Directeur. Va savoir. Un souvenir de Vilmon pourrait l’attester. Vaguement. Pour lui, tout ce qui concerne cette époque est vague. Il s’efforçait de ne pas trop penser pour ne pas engendrer trop de souvenirs, à cause de l’école quittée quelques mois plus tôt. Cinq classes primaires seulement. Une par niveau, réparties dans trois baraquements de bois — jaune paille dedans, noircis d’intempéries dehors — avec poêle à charbon, institutrices qui ne criaient jamais d’ordres militaires, arbres vénérables dans une petite cour cernée de murs couverts de lierre, activités de plein air, expression artistique ou manuelle une fois par semaine et une semaine complète à la fin de chaque trimestre. Vilmon y avait été bien. Il s’y était fait quelques amis. Un en tout cas. Même deux. Sauf que le second n’en était pas un. Pas vraiment, puisqu’à cause de lui il préférait ne pas se rappeler ce petit lycée qu’il aurait dû regretter. Ce « petit lycée », abusivement nommé tel parce que rattaché au Lycée de filles de la ville, accueillait pour moitié des garçons auxquels il était précisé au début de chaque année qu’ils étaient là invités et non de plein droit ; histoire de policer une mixité rare à l’époque. Pire encore : il ne pouvait le regretter car, s’il ne l’avait pas quitté, il aurait subi une abominable mise à mal. Il était parti avant que ce monde paisible qu’il aimait le rejette avec dégoût. Ainsi mieux valait pour lui oublier ce passé alors qu’il ne se faisait pas à son présent de hordes hurlantes et d’ordres abscons. C’était comme un enchantement mauvais qui lui enjoignait de ne pas s’appesantir, de ne rien mémoriser sur rien afin de ne pas avoir, plus tard, à déplorer de perte.
C’est sans doute pour ça qu’il n’est jamais parvenu à se rappeler de quoi Michel et lui se parlèrent la première fois. Seules certitudes : le père de Michel était militaire en Afrique du Nord, le grand-père de Vilmon l’avait été sur le même continent. Ce serait d’avoir eu ça en commun, un être cher en Afrique, qui les aurait rapprochés ? Certes, la guerre d’Algérie battant son plein en cette dernière année de la décennie cinquante, ça n’avait rien d’original, et l’Afrique du grand-père, plus au sud, était d’une autre époque mais, parti y travailler après son retour à la vie civile, il s’y trouvait encore puisque mort et enterré là-bas. Vilmon ne l’avait pas connu. Le père de Michel était vivant. Mais Michel ne l’avait peut-être pas beaucoup connu non plus. Là-dessus il était flou. Sur sa mère également. D’elle, il ne disait rien sinon qu’elle était très jeune, très belle et qu’il l’adorait. Si l’on tentait d’en savoir plus, le regard dont il toisait l’indiscret signifiait qu’on s’approchait de choses cachées, qui le resteraient, et ne devaient susciter aucun commentaire. Il habitait avec sa grand-mère une petite maison d’une stupéfiante pauvreté. Un terme que Vilmon n’employait pas. Cette masure, sa cheminée fumante, ses clapiers, son poulailler, ses huis de guingois, sa cour remplie d’objets improbables, coincés entre une cité HLM et une zone pavillonnaire, au bord d’un îlot qui hésitait entre jardin abandonné, terrain vague, chantier de construction délaissé, était surtout un univers comme il n’en avait jamais vu, hors les livres de contes. Plus tard, il fut toujours incapable de reconstituer mieux que ça. Les souvenirs étaient disparates. En fait, ça se confirme, durant cette année-là il évitait de penser pour oublier ce qu’il s’était passé au petit lycée. Oublier surtout ce à quoi il avait échappé de justesse grâce au déménagement familial qui, en le menant dans une des trois cités HLM surpeuplées de ce coin de banlieue, l’avait sauvé de la dénonciation par l’amie de la fille qui... Si ça lui revenait, la vie devenait impossible. La honte le tenaillait, il sursautait, geignait, s’agitait sans rien améliorer. Il ne pouvait qu’attendre. Attendre que vienne l’oubli. Sans en parler. Sans laisser le souvenir l’effleurer. Est-ce ça qui les avait rapprochés, Michel et lui : des choses cachées qui exigeaient le silence ? Des choses auxquelles Michel, lui aussi, voulait échapper ? Avaient-ils ensemble rêvé d’échappées plus concrètes ? Possible. Pas certain. Ce à quoi ils occupaient les moments où ils étaient ensemble reste également très flou, mais ils étaient toujours d’accord. Ou s’arrangeaient pour l’être. Vilmon avait notamment accepté un dimanche d’être enfant de chœur aux côtés de Michel sans en avoir envie.
Il n’avait pas aimé l’odeur du prêtre ni son sourire, ni ses plaisanteries sur le fond de vin dans les burettes « pas perdu pour tout le monde ! », ni la pièce qu’il avait reçue à la fin de l’office. Il n’avait pas renouvelé l’expérience. De toute façon, il n’aimait pas l’idée de Dieu. Son premier désaccord avec Michel ? Par la suite, ils ont cessé de se voir, ou peut-être est-ce Michel qui a cessé de lui parler. Ou qui est parti. Peut-être a-t-il passé moins d’une année dans la classe de Vilmon. Peut-être sa grand-mère est-elle tombée malade et sa mère serait venue le chercher, ou un oncle, une tante ? Qu’importe, l’essentiel fut une autre discorde. Avant celle sur la messe ? Plutôt après, à l’issue d’un après-midi de plein air. Rares dans cet établissement, ils se réduisaient à une marche pour atteindre le parc d’un château, joyau de cette banlieue et plus proche espace vert, où les deux classes qui faisaient route ensemble, sous la houlette des deux enseignants, avaient un peu de temps pour des jeux collectifs avant le retour à l’école qui, ce jour-là, avait été plus rapide qu’à l’ordinaire. Il faisait beau. La maîtresse et le maître de l’autre classe avaient décidé de laisser leurs élèves finir la journée dans la cour, les invitant à jouer calmement. Aux fenêtres des bâtiments, on distinguait des têtes penchées sur d’ennuyeux devoirs. En cas d’excès de bruit, ce serait retour en salle, où l’on trouverait une petite dictée adéquate pour attendre la sonnerie. Cela précisé, la maîtresse s’était mise à converser avec son collègue. Michel avait un ballon. Le seul. Il avait évidemment refusé les jeux au pied de peur qu’un shoot, pour avoir abouti dans une fenêtre, provoque confiscation et dictée. Mais il n’y avait pas que ça. Forcément quelque chose s’était mis en place avant. Quelque chose qui permit ce qu’il advint. Quelque chose auquel Vilmon avait participé. En élément actif. Conseiller ou second d’un groupe dont Michel était devenu le chef ? Ils étaient à l’âge où l’on aime les bandes, les clans, les sociétés secrètes. S’étaient-ils amusés, Michel et lui, dès le début de leur amitié, de ces idées si bien accordées aux choses cachées qui doivent le rester ? En tout cas ce jour-là, dans la cour inondée d’un soleil de fin d’après-midi, tous les élèves présents s’étaient retrouvés à courir en rond — en silence comme exigé par la maîtresse. Michel était au centre du cercle. Y avait-il eu déjà quelque chose de ce genre au parc ? Un groupe autour de Michel avec Vilmon pour second ? Et avant, bien avant, des esquisses de ce groupe, de ce clan dont ils étaient les deux seuls membres ? Puis, cet après-midi-là, Michel avait proposé à d’autres de jouer et,
le ballon étant à lui, il avait imposé ses règles. Une partie de balle au prisonnier — deux camps, deux tribus — agrémentée de quelques complications enfantines ? Et là, dans la cour, ça continuait, mais avec des règles adaptées aux consignes de la maîtresse : pas de bruit, pas de shoots. Les élèves couraient en lançant le ballon qu’il ne fallait pas laisser tomber. Vilmon courait lui aussi. Michel était seul au milieu. Soudain, Vilmon vit la maîtresse. Elle les observait. Jusque-là, elle avait papoté avec son collègue. À présent ils se taisaient. Ils regardaient en silence la ronde des coureurs. Elle, surtout. Yeux attentifs, visage sévère (accent aigu, accent grave). Elle était assez loin, pourtant Vilmon comprit : quelque chose n’allait pas, et il eut la certitude immédiate que ce quelque chose lui-même le percevait depuis un moment. Depuis le début ? Probablement. Aussitôt, il sut qu’il n’aimait pas courir ainsi. Donc… il ne devait pas. Ça se formula d’abord comme une injonction : il ne fallait pas courir. Une obligation combattant une autre ? Une obligation supérieure qui s’imposait ? C’était la prérogative des adultes, des maîtres d’école de donner des ordres, de faire courir, donc — Cependant, là encore, il n’y avait pas que ça. Autre chose se dessinait : ses camarades couraient en cercle dans cette cour et… autant pour lui, alors que, c’était désormais évident, non seulement il devait cesser de courir avec eux, mais il devait s’opposer à ce jeu, parce que cette course en rond était… lamentable ou autre chose de pire dont il ne savait encore rien dire. À cet instant, Michel désignait un des coureurs et déclarait à voix forte que celui-ci devenait colonel. Il l’avait mérité par la précision de ses tirs. Venait-il d’inventer cette attribution de grade, ou avait-elle fait partie du jeu au parc ? Déjà, il désignait un autre coureur. C’est ce moment que choisit Vilmon pour sortir du cercle et marcher vers le centre qui lui faisait signe de reprendre sa place, grondant, criant presque : – On ne rompt pas les rangs, on court ! Vilmon alla pourtant jusqu’à Michel et lâcha bien haut, bien fort, que s’il continuait ils allaient tous finir général. Une troupe ridicule d’être composée de tant d’officiers (il ne connaissait pas encore l’expression « armée mexicaine »). Ça ne remettait pas le jeu en cause. Seulement une dérive. Et ça n’avait rien à voir avec son ressenti — que de toute façon il ne savait nommer. L’important avait été de sortir du cercle, de marcher vers son centre pour dire non.