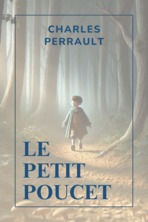Extrait du livre Candide
CANDIDE
écrit par Voltaire
aux éditions Storyplay'r
CANDIDE
Chapitre premier :
Comment Candide fut élevé dans un beau château, et comment il fut chassé d’icelui. Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Thunder-ten-tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison qu’on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu’il était fils de la sœur de monsieur le baron, et d’un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser, parce qu’il n’avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l’injure du temps.
Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d’une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin ; ses palefreniers étaient ses piqueurs ; le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l’appelaient tous Monseigneur, et ils riaient quand il faisait des contes. Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s’attirait par là une très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde âgée de dix-sept ans était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père.
Le précepteur Pangloss était l’oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère.
Pangloss enseignait la métaphysico-théologocosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y a
point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles.
Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux ; aussi monseigneur a un très beau château ; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé : et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l’année : par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise : il fallait dire que tout est au mieux.
Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment ; car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu’il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire.
Il concluait qu’après le bonheur d’être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur était d’être mademoiselle Cunégonde, le troisième, de la voir tous les jours, et le quatrième, d’entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre.
Un jour Cunégonde en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu’on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin ; elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes ; et s’en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d’être savante ; songeant qu’elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne.
Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit ; Candide rougit aussi ; elle lui dit bonjour d’une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu’il disait. Le lendemain après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent ; Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui prit innocemment la main, le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière ; leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s’enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s’égarèrent. Monsieur le baron de Thunder- ten-tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière ; Cunégonde s’évanouit ; elle fut souffletée par madame la baronne dès qu’elle fut revenue à elle-même ; et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.
Chapitre second : Ce que devint Candide parmi les Bulgares.
Candide chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux qui renfermait la plus belle des baronnettes ; il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons ; la neige tombait à gros flocons. Candide tout transi se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s’appelle Valdberghoff-trarbk-dikdorff, n’ayant point d’argent, mourant de faim et de lassitude. Il s’arrêta tristement à la porte d’un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquèrent : Camarade, dit l’un, voilà un jeune homme très bien fait, et qui a la taille requise : ils s’avancèrent vers Candide, et le prièrent à dîner très civilement. “Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d’honneur, mais je n’ai pas de quoi payer mon écot”.
Ah monsieur ! lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien : n’avez-vous pas cinq pieds cinq pouces de haut ? “Oui, messieurs, c’est ma taille”, dit-il en faisant la révérence. Ah monsieur ! mettez-vous à table ; non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu’un homme comme vous manque d’argent ; les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison, dit Candide ; c’est ce que monsieur Pangloss m’a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. On le prie d’accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet, on n’en veut point, on se met à table ; N’aimez-vous pas tendrement… ? Oh oui ! répond-il, j’aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l’un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n’aimez pas tendrement le roi des Bulgares ? Point du tout, dit-il, car je ne l’ai jamais vu. Comment ? C’est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. Oh ! Très
volontiers, messieurs ; et il boit. C’en est assez, lui dit-on, vous voilà l’appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares ; votre fortune est faite, et votre gloire est assurée.
On lui met sur-le-champ les fers aux pieds, et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne trente coups de bâton ; le lendemain il fait l’exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que vingt coups ; le surlendemain on ne lui en donne que dix, et il est regardé par ses camarades comme un prodige.
Candide tout stupéfait ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s’avisa un beau jour de printemps de s’aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c’était un privilège de l’espèce humaine, comme de l’espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n’eut pas fait deux lieues, que voilà quatre autres héros de six pieds qui l’atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu’il aimait le mieux d’être fustigé trente-six fois par tout le régiment, ou de recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle.
Il eut beau dire que les volontés sont libres, et qu’il ne voulait ni l’un ni l’autre, il fallut faire un choix ; il se détermina, en vertu du don de Dieu, qu’on nomme liberté, à passer trente-six fois par les baguettes ; il essuya deux promenades. Le régiment était composé de deux mille hommes ; cela lui composa quatre mille coups de baguette, qui, depuis la nuque du cou jusqu’au cul lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide n’en pouvant plus demanda en grâce qu’on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête ; il obtint cette faveur ; on lui bande les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s’informe du crime du patient ; et comme ce roi avait un grand génie, il comprit, par tout ce qu’il apprit de Candide que c’était un jeune métaphysicien, fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles.
Un brave chirurgien guérit Candide en trois semaines avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau, et pouvait marcher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.
Chapitre troisième : Comment Candide se sauva d’entre les Bulgares, et ce qu’il devint.
Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes.
Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque.
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d’aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d’abord un village voisin ; il était en cendres : c’était un village abare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles, éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs ; d’autres à demi brûlées criaient qu’on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés.
Candide s’enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares ; et les héros abares l’avaient traité de même. Candide toujours marchant sur des membres palpitants, ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac, et n’oubliant jamais mademoiselle Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande : mais ayant entendu dire que tout le
monde était riche dans ce pays-là, et qu’on y était chrétien, il ne douta pas qu’on ne le traitât aussi bien qu’il l’avait été dans le château de monsieur le baron avant qu’il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunégonde.
Il demanda l’aumône à plusieurs graves personnages, qui lui répondirent tous que, s’il continuait à faire ce métier, on l’enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre.
Il s’adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul une heure de suite sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur le regardant de travers, lui dit : “Que venez-vous faire ici ? Y êtes-vous pour la bonne cause ?” “Il n’y a point d’effet sans cause, répondit modestement Candide, tout est enchaîné nécessairement, et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d’auprès de mademoiselle Cunégonde, que j’aie passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain, jusqu’à ce que je puisse en gagner ; tout cela ne pouvait être autrement”. Mon ami, lui dit l’orateur, croyez-vous que le pape soit l’Antéchrist ?” “Je ne l’avais pas encore entendu dire, répondit Candide ; mais qu’il le soit, ou qu’il ne le soit pas, je manque de pain.” “Tu ne mérites pas d’en manger, dit l’autre ; va, coquin ; va, misérable, ne m’approche de ta vie.” La femme de l’orateur ayant mis la tête à la fenêtre, et avisant un homme qui doutait que le pape fût antéchrist, lui répandit sur le chef un plein… “Ô ciel ! à quel excès se porte le zèle de la religion dans les dames !”
Un homme qui n’avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à deux pieds sans plumes, qui avait une âme ; il l’amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de deux florins, et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de Perse qu’on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant presque devant lui, s’écriait : “Maître Pangloss me l’avait bien dit que tout est au mieux dans ce monde ; car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de la dureté de ce monsieur à manteau noir, et de madame son épouse.”
Le lendemain en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la gorge, tourmenté d’une toux violente, et crachant une dent à chaque effort.
Chapitre quatrième :Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie le docteur Pangloss, et ce qui en advint. Candide plus ému encore de compassion que d’horreur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu’il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes, et sauta à son cou. Candide effrayé recule. “Hélas ! dit le misérable à l’autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss ?” “Qu’entends-je ? Vous, mon cher maître ! Vous, dans cet état horrible ! Quel malheur vous est-il donc arrivé ? Pourquoi n’êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux ? Qu’est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d’œuvre de la nature ?” “Je n’en peux plus, dit Pangloss.” Aussitôt Candide le mena dans l’étable de l’anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain ; et quand Pangloss fut refait : “Eh bien, lui dit-il, Cunégonde ?”
“Elle est morte, reprit l’autre.” Candide s’évanouit à ce mot : son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l’étable. Candide rouvre les yeux. “Cunégonde est morte ! Ah meilleur des mondes, où êtes-vous ? Mais de quelle maladie est-elle morte ? Ne serait-ce point de m’avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied ?” “Non, dit Pangloss, elle a été éventrée par des soldats bulgares, après avoir été violée autant qu’on peut l’être ; ils ont cassé la tête à monsieur le baron, qui voulait la défendre ; madame la baronne a été coupée en morceaux ; mon pauvre pupille traité précisément comme sa sœur ; et quant au château, il n’est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre ; mais nous avons été bien vengés, car les Abares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare.”
À ce discours Candide s’évanouit encore : mais revenu à soi, et ayant dit tout ce qu’il devait dire, il s’enquit de la cause et de l’effet, et de la raison suffisante qui avaient mis Pangloss dans un si piteux état.
“Hélas ! dit l’autre, c’est l’amour ; l’amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l’univers, l’âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour.” “Hélas ! dit Candide, je l’ai connu cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme ; il ne m’a jamais valu qu’un baiser et vingt coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable ?”
Pangloss répondit en ces termes : “Ô mon cher Candide ! vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne ; j’ai goûté dans ses bras les délices du paradis, qui ont produit ces tourments d’enfer dont vous me voyez dévoré ; elle en était infectée, elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d’un cordelier très savant qui avait remonté à la source ; car il l’avait eue d’une vieille comtesse, qui l’avait reçue d’un capitaine de cavalerie, qui la devait à une marquise, qui la tenait d’un page, qui l’avait reçue d’un jésuite qui, étant novice, l’avait eue en droite ligne d’un des compagnons de Christophe Colomb.
Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me meurs.”
“Ô Pangloss ! S’écria Candide, voilà une étrange généalogie !n’est-ce pas le diable qui en fut la souche ?” “Point du tout, répliqua ce grand homme ; c’était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire ; car si Colomb n’avait pas attrapé, dans une île de l’Amérique, cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l’opposé du grand but de la nature, nous n’aurions ni le chocolat ni la cochenille ; il faut encore observer que jusqu’aujourd’hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais, ne la connaissent pas encore ; mais il y a une raison suffisante pour qu’ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles.
En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées composées d’honnêtes stipendiaires, bien élevés, qui décident du destin des États ; on peut assurer que quand trente mille hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ vingt mille vérolés de chaque côté.”
“Voilà qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir.” “Eh comment le puis-je ? dit Pangloss, je n’ai pas le sou, mon ami, et dans toute l’étendue de ce globe on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu’il y ait quelqu’un qui paye pour nous.”
Ce dernier discours détermina Candide ; il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques, et lui fit une peinture si touchante de l’état où son ami était réduit, que le bonhomme n’hésita pas à recueillir le docteur Pangloss ; il le fit guérir à ses dépens. Pangloss dans la cure ne perdit qu’un œil et une oreille. Il écrivait bien, et savait parfaitement l’arithmétique.
L’anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de deux mois, étant obligé d’aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ses deux philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n’était pas de cet avis. “Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups : Dieu ne leur a donné ni canon de vingt-quatre, ni baïonnettes ; et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes, et la justice qui s’empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers.” “Tout cela était indispensable, répliquait le docteur borgne, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien.” Tandis qu’il raisonnait, l’air s’obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête, à la vue du port de Lisbonne.