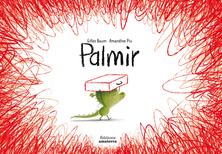Extrait du livre Le goût salé du vent
Le goût salé du vent de Caroline Toury aux éditions Amaterra.
Le goût salé du vent
Le goût salé du vent Le bernard-l’ermite ou pagure est un crustacé habitant la coquille restée vacante d’un autre coquillage. Sa larve ressemble à une petite crevette. Les mues suivantes font apparaître un petit pagure, qui devra trouver une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les bernard-l’ermite peuvent se combattre pour une
coquille, ou les échanger à l’occasion de grands rassemblements. Lorsqu’il est en recherche d’une coquille, il est extrêmement vulnérable. Le pagure géant est le plus grand bernard-l’ermite des Caraïbes. Il loge dans des coquilles volumineuses, souvent celles de lambis. Il possède une paire de pinces puissantes. La couleur de son corps varie du mauve lavande au gris brunâtre ou rougeâtre, et sa texture écailleuse est irrégulière. Les yeux, perchés au bout d’un pédoncule, sont verts et les antennes, rayées de blanc et de rouge foncé. On le trouve principalement sur les fonds sableux et les herbiers. Source : BRAVI E., FREY G., « Arthropodes de la zone Caraïbe », in Encyclopédie des fonds marins, Orion, 2021, pp. 57-58. Je m’appelle Prudence. Prudence Bienvenue. J’ai douze ans et demi, et c’est mon premier jour d’école. Je débarque. Dans tous les sens du terme. J’atterris dans un monde dont je ne connais pas les codes, une réalité qui me paraît laide et grise, un univers qui ne m’intéresse pas. Il y a un mois encore, j’étais sur la mer, dans le cocon où j’ai grandi. Un cocon à voile poussé par les vents. Un cocon douillet, mouillé et salé. Un cocon de rires et de partages en famille. Cinq doigts de la main prêts à toutes les aventures. Sauf à la dernière. Solange a eu du mal à lâcher ma main devant la porte de son école. Elle avait l’air toute petite, écrasée par son cartable à bretelles neuf et presque vide. Pendant un moment, on a regardé les enfants qui arrivaient, pour
voir comment il fallait faire. La directrice s’est approchée, souriante, et a demandé à Solange si c’était elle la nouvelle en CE2. Puis, sans un mot, ma soeur est partie rejoindre les autres dans la cour, en longeant de grandes fenêtres sur lesquelles des dessins colorés tentaient d’égayer la grisaille de novembre. J’ai marché lentement vers le collège, ne sachant pas du tout à quoi ressemblerait ma journée, avec dans le ventre une envie urgente de rentrer chez mamie, au chaud, d’y retrouver papa et Gaston, et de me rouler en boule sous ma couette avec un bon livre. La pluie s’est mise à tomber. J’aime la pluie. Quand on est en mer, la pluie vient avec le vent. Le bateau gîte, on ne quitte plus sa salopette de ciré, tout devient humide. Les grosses averses mélangent sur les peaux eau douce et eau de mer, les cheveux sont collés, les doigts fripés. On dort comme on peut, n’importe quand et souvent n’importe où, au milieu du carré ou serrés avec Solange et Gaston sur la couchette arrière, celle qui bouge le moins. Quand on est au mouillage, la pluie apporte des relents d’humus. On sent la terre proche et en même temps moins accessible. On se calfeutre dans le carré, à l’abri. C’est le moment où on aime jouer aux cartes, le moment où papa décide de faire un gâteau qui embaume toute la cabine. Ici, la pluie sert juste à fabriquer des flaques grises. Les gens rentrent les épaules et accélèrent le pas, tête baissée. Chacun essaie d’arriver le plus vite possible à sa destination. La mienne est là, bâtiment immense posé le long d’un large trottoir. Je sais à quoi ressemble un collège, j’ai vu ces salles remplies d’élèves en uniforme par les fenêtres sans vitres des écoles sénégalaises. J’ai écouté pendant des heures Kate me raconter les profs et les copains de la middle school sur les pontons de Port Charlotte. J’en ai une idée. Une vague idée, je crois. Il m’est même arrivé d’envier ces groupes de filles nattées balançant leurs sacoches dans les rues poussiéreuses de Kingston. Et pourtant, à l’instant de franchir les hautes portes vitrées de l’établissement, j’ai au fond de moi la sensation de remiser ma liberté, d’enfiler une tenue de prisonnière, et de me livrer pieds et poings liés à une machine sans âme. La nuit tombe à 17 heures, juste le temps au sortir du collège d’apercevoir la lueur mauve du soleil déjà enfoncé derrière l’horizon des immeubles. Raconter
cette première journée me paraît vain ce soir, tant elle m’a semblé à la fois intense et vide. J’ai partagé ma table avec des adolescents dont j’ai déjà oublié les noms. Je n’ai rencontré ni chaleur ni hostilité. Je ne me suis pas fait remarquer. Je suis devenue anonyme parmi les anonymes. J’ai écouté, imperturbable malgré l’ennui, les professeurs, en domptant mes pensées qui ne cherchaient qu’à s’envoler. J’ai tout fait pour me fondre dans l’environnement. Comme le caméléon. Papa dit que les marins sentent toujours, au retour du grand large, la terre ferme balancer sous eux pendant quelques jours. J’aimerais que ce bercement ne s’arrête jamais. CHAPITRE 2 (Flash-back) J’ai six ans, Solange deux. Nous jouons avec des chutes de bois dans un coin du hangar. J’ai fabriqué une sorte de tipi dans lequel Solange installe sa poupée. M m’a chargée de surveiller ma petite soeur, qu’elle n’aille pas courir sous les coques des bateaux alignés dans le chantier naval. Il faut dire que c’est tentant. Depuis un an, nous venons ici chaque week-end et je les connais tous. Sam II est le plus vieux, il est tout en bois et sent le vernis. Son propriétaire, Fred, est copain avec les parents, il leur prête main-forte quand il faut manipuler quelque chose de trop lourd pour eux deux. Kevin et Christel, les seuls vrais Bretons du chantier, retapent un catamaran de neuf mètres, un sacré boulot !
Les parents se moquent gentiment des hublots qu’ils ont prévu d’installer un peu partout, dont un pour voir sous l’eau. Papa dit que ça ne tiendra jamais et qu’il ne risque pas de monter à bord, même pour prendre l’apéro. Il y a aussi Gérard et son Amaya jaune, Hello de Line et Alex qui sont presque prêts à partir, et évidemment Loup-Garou. C’est lui le plus beau, avec son nouveau mât et sa coque rouge. C’est M qui a choisi la couleur. Je me souviens vaguement des premières fois où on a parlé du départ, papa étalant sur la table à peine débarrassée une grande carte du monde sur laquelle les pays colorés semblaient former un puzzle géant. — Fais attention, Prudence, ta tresse trempe dans le Pacifique Nord ! lançait-il. Alors, par où on commence ? Les parents dessinaient sur le bleu des océans des itinéraires imaginaires, et se disputaient en riant l’ordre des étapes. Invoquant pêle-mêle saisons des alizés, fêtes locales et tarifs des ports pour l’emporter, ils finissaient par me demander mon avis. À vrai dire, je ne comprenais pas grand-chose. J’avais du mal à faire le lien entre ces promesses de rencontres avec des dauphins ou des albatros et nos journées au chantier, dans la sciure et les odeurs de résine. Notre quotidien était doux et joyeux. M nous déposait chez mamie avant de se rendre à son travail. J’adorais aller chez mamie. À peine arrivées, été comme hiver, nous descendions toutes les trois au parc de jeux en bas de l’immeuble. Le toboggan glissait mal et le bac à sable était plein de brindilles, mais nous aimions y creuser des tunnels dans lesquels nous introduisions des gendarmes, ces insectes rouge et noir qui pullulaient au pied des tilleuls. Nous rentrions les mains sales et le ventre creux, et mamie nous réchauffait les bons petits plats qu’elle avait pris soin de cuisiner la veille en notre absence. Puis, pendant que Solange faisait la sieste, nous nous asseyions toutes les deux autour de la table de la salle à manger, et elle m’apprenait les lettres. Nous les dessinions ensemble, je m’appliquais à reproduire le « P » de mon prénom. J’ai vite été capable de lire des mots entiers, puis des phrases. Nous jouions à la bataille et aux petits chevaux jusqu’à ce que Solange nous rappelle que c’était l’heure du goûter. En fin de journée, papa venait nous chercher. Mamie, fatiguée, lui répétait souvent que je pourrais aller à l’école, que j’y trouverais des amies.
— Mais c’est toi sa meilleure amie ! lui glissait-il à l’oreille. Elle secouait la tête avec un sourire attendri. — Tu t’en sors toujours par une pirouette ! Tiens, n’oublie pas le sac des filles, j’ai mis deux parts de gâteau pour vous. — Que ferait-on sans toi ? la taquinait-il avant d’embarquer Solange sous un bras et nos affaires sous l’autre. Et puis un jour, ce qui n’était jusqu’alors qu’un rêve est subitement devenu réel. Nous nous apprêtions à partir pour de bon. Loup-Garou a quitté le hangar et nous l’avons retrouvé flottant sur l’eau grise du port de Saint-Nazaire. C’était bizarre de le regarder de haut depuis le quai, il me paraissait soudain minuscule. Les parents avaient organisé une fête avec les copains du chantier et quelques amis. Ils souriaient et se jetaient des regards en coin comme une bande de conspirateurs qui auraient réussi un bon coup. J’ai foncé vers la couchette que j’allais désormais partager avec Solange : mes doudous étaient alignés au fond, et M avait installé une couette toute neuve décorée de dauphins bleu clair. L’un des petits casiers destinés à ranger nos affaires était rempli de livres. C’était chez moi, mon nouveau chez-moi. Soudain, tout prit forme. Nos premières étapes – pour nous amariner, disait papa – seraient Belle-Île puis les ports de la Bretagne Sud, avant de descendre vers l’Espagne. Ensuite, le grand large, le vrai, la traversée de l’Atlantique avec une escale aux Açores. M nous promettait que nous croiserions des baleines. Les parents rivalisaient d’arguments pour nous convaincre : ils vendaient leur projet comme si nous pouvions choisir de partir ou non, ma soeur et moi, comme si la seule perspective de voyager tous les quatre, blottis dans le ventre de Loup-Garou, ne pouvait suffire à nous remplir d’envie et d’excitation. Mamie avait une drôle de voix quand elle nous a serrés dans ses bras le jour du grand départ. L’aventure commençait. Rien ne pouvait nous arriver. Tout pouvait nous arriver.
CHAPITRE 3 Ce cours de SVT est interminable. Depuis trentecinq minutes, madame Correl s’acharne à susciter chez ses élèves une démarche scientifique permettant de prouver l’absorption d’oxygène par les poissons. J’aimerais lui faire remarquer que c’est démontré depuis bien longtemps et que, si elle voulait passionner son auditoire, elle pourrait nous parler des poulpes et de leurs neuf cerveaux, des oxudercinaes, ces poissons qui déambulent à l’air libre dans la boue des mangroves, ou encore de la migration des anguilles qui naissent ici, dans les méandres de la Loire, et qu’on retrouve en mer des Sargasses, de l’autre côté de l’Atlantique. Mais madame Correl n’a aucun talent pour le stand-up. Son public s’ennuie et, assommé, il filera dans vingt-trois
minutes rejoindre au pas de course la salle B21 pour un formidable show autour des Fourberies de Scapin. Le troupeau de mes camarades d’infortune ne semble ni lassé, ni enthousiaste. Depuis trois mois, tel un agent infiltré, j’observe les moeurs et usages de la classe. J’ai ma place réservée au premier rang dans chaque salle. Personne ne veut s’y mettre. On m’adjoint régulièrement un comparse extirpé des derniers rangs pour cause de bavardage. Il s’assoit lourdement à mes côtés, et nous n’échangeons rien de plus que le grincement simultané de nos deux chaises. Papa s’inquiète. Il me demande souvent si j’ai des amis, ce que je mange à la cantine ou qui est mon prof préféré. Je le rassure : tout va bien. À bord de Loup-Garou, nous étions à la fois toujours et jamais à l’école. Par temps calme et aux escales, je m’installais avec papa pour réviser la conjugaison et l’orthographe. Il relisait avec attention les histoires que j’écrivais et me proposait souvent quelques corrections. — Pense à tes futurs lecteurs, se moquait-il. Son domaine à elle, M, c’étaient les maths. J’ai appris les fractions en mer en faisant du pain avec une recette prévue pour un régiment, j’ai compris les multiplications en calculant le budget nécessaire pour notre séjour au port de Funchal et j’ai tracé sur nos cartes des triangles précis pour nous localiser. Tout était prétexte à apprendre : les oiseaux, le vent, les pavillons des cargos, la couleur de la mer aux abords des côtes, les bonites tout juste pêchées éventrées sur le pont, les fleurs d’hibiscus aux pistils intrigants. Avec Solange, nous passions nos soirées à lire, blotties dans notre lit commun. Quand le bateau bougeait trop, ou que les batteries ne permettaient plus de garder notre loupiote allumée, nous jouions à nous remémorer les histoires que nous connaissions par coeur, récitant nos passages préférés. Plus que l’eau et les vivres, les livres étaient devenus une quête essentielle à chaque escale… Bien vite, notre petite bibliothèque de bord s’enrichit d’ouvrages en espagnol, en anglais, en portugais, dont nous tentions de deviner le sens en prononçant les mots avec des accents improbables qui nous faisaient mourir de rire. Chez mamie, nous partageons encore la même chambre, Solange et moi, mais nous avons désormais