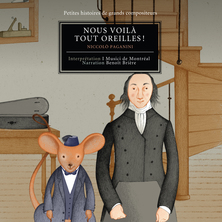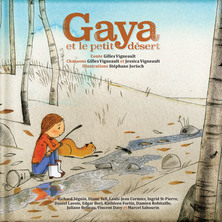Extrait du livre Le vieillard et l'enfant
Le vieillard et l'enfant de Gabrielle Roy, Dominique Fortier et Rogé aux éditions La Montagne Secrète
Le vieillard et l'enfant
Christine habitait une petite ville où le temps s’écoulait le plus lentement du monde dans la grande chaleur de l’été. Elle en explorait les rues en patins à roulettes ou en échasses, pour aller plus vite ou voir plus loin. Ce matin-là, sous les feuilles en étoiles d’un petit érable, elle découvrit, assis sur une chaise droite, un vieux monsieur qui la regarda arriver de très loin.
Christine fit un pas trop vite, s’emmêla dans les cordes de ses échasses et s’affala juste devant le vieillard qui se leva précipitamment pour l’aider à se relever. Constatant qu’elle n’était pas blessée, plutôt que de la consoler, monsieur Saint-Hilaire la félicita : — Il faut être bien brave, pour monter sur des échasses. Ce n’est pas tout le monde qui oserait. Et puis il fait chaud, surtout pour qui voyage. Car le vieillard avait compris tout de suite que Christine était une exploratrice.
Le lendemain, aussitôt après le petit déjeuner, la fillette courut dans la rue voisine. Le vieillard était déjà là, assis dans l’ombre verte du petit érable. — Tiens, tu es à pied aujourd’hui ? — Oui, à pied, parce que je vais loin. Le vieillard hocha la tête. Il avait déjà deviné que Christine, pour faire en imagination ses voyages lointains, se transformait à son gré, devenant pendant une heure le Chinois de la blanchisserie qui ramassait le linge à laver, le vieux colporteur italien qui vendait mille et une babioles, une princesse des Mille et une nuits ou un musicien ambulant. — Et qui es-tu, aujourd’hui ? demanda le vieillard. — La Vérendrye ! cria-t-elle. Je suis La Vérendrye ! Et je dois aller découvrir toutes les terres à l’Ouest jusqu’aux montagnes Rocheuses. Si je ne suis pas tuée en route, avant ce soir j’aurai pris possession de l’Ouest pour le roi de France. — Dites-moi, monsieur La Vérendrye, repasserez-vous par ici ? Vous voyez, j’ai passé l’âge des grands voyages épuisants. Je ne peux plus aller en personne contempler les paysages et les spectacles de ce monde. Mais si vous venez me les décrire, alors ce sera comme si je les avais vus. — Je viendrai. — Promis ? — Promis.
Christine partit en courant vers un petit bois de chênes où elle ramassa quelques glands en attendant de repartir faire son rapport. Et puis elle revint vers le vieillard qui l’attendait. — Je les ai vues ! annonça-t-elle triomphalement. — Quoi ! Vous êtes donc allé si loin ? Vous avez vu les Rocheuses ? Ah, décrivez-les-moi. — Eh bien, elles sont si hautes qu’elles dépassent les poteaux de téléphone ! Et si grandes qu’on dirait des baleines échouées sur l’horizon ! Et ce qui était étrange, c’est que dans les yeux du vieillard, tout à coup, apparut comme le reflet de ces montagnes grises et rêveuses.
Jamais de mémoire d’homme il n’y avait eu d’été si chaud au Manitoba. Dès le matin, le soleil plombait. On dormait mal, on se réveillait en sueur, on se levait grognon et on se couchait plus irrité encore. Chaque matin, la mère de Christine sortait sur la galerie. Elle annonçait, en levant son doigt en l’air comme si c’était un thermomètre : — Aujourd’hui il va faire 98, peut-être 99. Elle regardait sa fille et soupirait : — Ah, si seulement je pouvais t’envoyer un peu à la campagne pour te rafraîchir. Et puis elle baissait la tête et rentrait pour ne pas laisser entrer l’air chaud dans la maison.
Ce matin-là, Christine partit d’un pas lent vers la rue voisine. Son imagination l’avait désertée. Le Chinois, l’Italien, la princesse et le musicien l’avaient abandonnée : toute seule, elle traînait les pieds. Le vieillard l’attendait sous son arbre comme sous un parasol. Christine s’assit près de lui dans l’herbe jaune. Doucement, il lui mit la main sur le front. — Comme tu as chaud ! dit-il. Et elle mit aussi sa petite main sur le vieux front. — Et vous aussi. — Est-ce que tu ne devrais pas être à la campagne chez tes oncles ? demanda le vieux. Mais il fallait de l’argent, pour aller à la campagne. Et cet été, de l’argent, la mère de Christine n’en avait guère. Il reste que la campagne était un sujet que Christine adorait, et qui lui valait souvent, dans ses compositions à l’école, un 98 ou un 99 — comme la température.