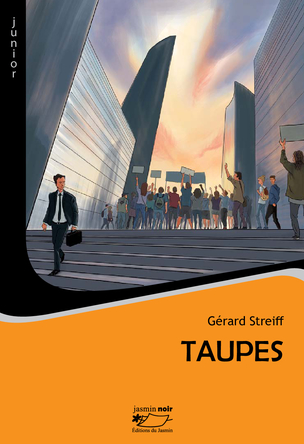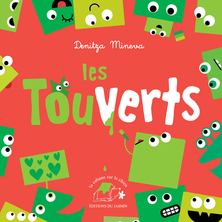Extrait du livre Taupes
Taupes de Gérard Streiff aux éditions du Jasmin
Taupes
Prologue — Bande de mafieux! — Pauvres clowns! — Prédateurs! — Parasites! — Banksters! — Fainéants! Traders et contestataires s’envoient des mots comme des tennismen s’échangent des balles. Du tac au tac. Pas de temps mort. On sent, aux intonations, à des mouvements divers aussi, qu’on va vite passer des paroles aux actes, des quolibets aux coups. Dans cette salle de marché, les opérateurs s’agacent de la soudaine intrusion des manifestants. On se jauge, on se mesure. Ça ressemble au début d’un combat de coqs quand les animaux font la ronde, se tournent autour avant de se becquer à mort. Caro se trouve au cœur de la tourmente, très exactement au milieu des protagonistes, coincée entre les deux camps. On la bouscule, on la prend à témoin, on hurle à ses oreilles. Le ton monte encore, ça va mal finir. La journée avait pourtant bien commencé.
1 Ce matin-là, Caro, chignon en palmier, avait mis sa tenue mode, tee-shirt sérigraphié du visage d’Iggy Pop, jean slim, baskets de ville et sac à dos en toile. La jeune fille devait entrer au lycée en septembre. En août, elle allait filer vers le grand Ouest, direction la Bretagne. Mais en ce début d’été, elle ne détestait pas accompagner ses parents, aujourd’hui sa mère, sur leur lieu de travail. Elle avait gardé cette habitude du collège, où la prof de français appréciait ses exposés sur ce genre de visites. Elle s’était donc rendue au Volcan. Ce bâtiment du quartier de la Défense venait juste d’être inauguré. Avec seulement trois étages, il faisait parent pauvre entre les tours SFR, EDF ou AREVA; même son hall d’accueil, pourtant impressionnant, était bien modeste comparé à celui des voisins. Mais Volcan était un petit bijou d’esthétisme, avec sa façade vitrée d’un bleu très doux, tout en ondulations, en courbes, en ouvertures. C’était aussi un concentré des dernières technologies, un modèle d’économie d’énergie, disait-on. Volcan abritait une agence financière, la Compagnie Générale, CG pour les connaisseurs. Pour entrer dans l’immeuble, il fallait pousser une porte-tambour. Celle-ci tournait, soupirait, on avait
l’impression que l’immeuble se plaignait. On accédait à un hall monumental, grand comme une cathédrale. L’espace était intimidant. C’était sans doute fait exprès, tout ce vide, histoire de rappeler au visiteur qu’il pénétrait dans un lieu respectable. Il y avait du marbre partout, au sol, au mur, une baie vitrée démesurée, une rangée de petits palmiers qui avaient l’air de s’ennuyer, deux ou trois fauteuils noirs perdus dans cette immensité et tout au fond, là-bas, un long comptoir d’accueil, près des ascenseurs. Caro trouvait l’endroit un peu froid. Elle aurait ajouté quelques boiseries sombres, des décorations diverses, des tentures aussi, mais personne, évidemment, ne lui avait demandé son avis. C’était le genre de lieu où on avait toujours envie de crier pour tester l’écho, mais Caro sentait que la dame derrière le guichet n’aurait pas apprécié. D’autant que la dame en question, Valia selon le badge qu’elle portait au revers de sa veste, c’était sa mère. Valia, plutôt facile à vivre à la maison, était hyper stressée au travail. Devant ses collègues, elle se montrait toujours tendue, très directive avec sa fille : fais pas ci, touche pas ça, dis bonjour à la dame. La barbe ! Caro supportait pourtant l’épreuve, car le monde des adultes, à commencer par ses parents, l’intriguait. Ils avaient tellement l’air de vivre sur une autre planète ; elle ne désespérait pas de comprendre un jour comment ils fonctionnaient. Et puis la vie du Volcan était pour elle un mystère à décrypter. Alors elle regardait sa mère saluer les entrants, vérifier les badges des salariés, échanger les cartes d’identité des visiteurs occasionnels contre un passe, répondre aux questions les plus saugrenues. « Les W.C. ? Au fond, à droite ! » Deux étages du Volcan étaient occupés par des salles de marché, trois cents opérateurs par plateau, six cents en tout. Une sorte d’usine high-tech peuplée de jeunes ingénieurs plutôt élégants, bien payés, arrogants mais pas trop. La première fois que Caro avait traversé l’une de ces surfaces, elle s’attendait à tomber sur une foire d’empoigne, une fournaise, comme le nom de l’immeuble le suggérait. D’ailleurs, elle avait en tête des images de bourse d’antan avec des hommes en manches de chemise, dans des postures dramatiques, le visage crispé, la main gauche plaquant un téléphone à l’oreille, le bras droit tendu et faisant un signe d’urgence vers on ne sait qui, hurlant comme dans une scène de naufrage. Mais tout ça datait un peu. Ici, pas de cris ni d’agitation, l’ambiance était feutrée, ouatée, cool. Un peu genre bibliothèque. L’espace baignait dans une relative pénombre, des lumières indirectes au sol aspergeaient sans excès les murs et chaque bureau était éclairé par un point lumineux, discret et précis. Les employés avaient des allures d’étudiants, des hommes souvent, quelques femmes aussi, chacun scotché devant une batterie d’écrans, trois, quatre, cinq ou plus, couverts de graphiques, de « camemberts », de courbes, de listings, de chiffres, de couleurs. Ce matin-là, Caro accédait aux étages pour la deuxième fois. Elle suivait, avec la bénédiction assez peu enthousiaste de sa mère, un groupe de visiteurs: des clients de la banque qui voulaient voir la machine de l’intérieur, des « bons clients » qu’on remerciait de la sorte, murmura Valia. À l’étage, dès la sortie de l’ascenseur, le responsable de la communication, blaser classique, pantalon gris souris aux plis amidonnés, prit en charge la délégation avec autorité. Martial Poupard était un homme sec, nerveux, au crâne
chauve et au teint plâtreux, ce teint qu’on a d’habitude sous les néons sauf que lui l’avait en permanence. Blasés ou surmenés, peu d’opérateurs se tournèrent vers les hôtes. Le cicerone commentait : « À l’armée, plus vous avez de barrettes, plus vous êtes gradé ; ici, plus vous avez d’écrans, plus vous comptez ! O.K. ? » À l’écouter un peu distraitement, on pouvait penser par moments qu’il parlait anglais; il baragouinait en effet dans un jargon hyper technique et concédait presque à contrecœur quelques traductions. — Nous voici dans le trading floor, une salle des marchés si vous voulez, on dit aussi front office ou floor, tout simplement floor. O.K. ? Une petite pause et il reprit : — Tous ces gens que vous voyez derrière leur écran, ce sont des…? Silence poli de l’assistance. —… des tré ? Dans le groupe, le luron de service plaça sa drôlerie : — Des traîtres ? — Des traders, allons, des traders! Vous connaissez ce mot, tout de même, c’est de l’anglais, comme le reste d’ailleurs. Un trader, c’est un opérateur de marché, O.K. ? Son petit public avait compris le rituel, et répondait à présent à chacune de ses interpellations, Caro également : O.K.! Soudain Poupard se crispa, apparemment sans raison. Il tressauta, gesticula, en proie à une sorte de dérèglement. La jeune fille finit par repérer l’objet de cette agitation : une mouche, ou une guêpe ou un frelon, elle n’aurait su dire, tournicotait autour du bonhomme. « Qui a amené ça? » s’énerva-t-il. Avec un exemplaire du Figaro Economie tout chiffonné, il tenta de repousser l’agresseur, n’y parvint pas. Le ton monta : « Y’a personne pour m’aider? » lâcha-t-il, comme s’il était confronté à un défi considérable. Il ne se calma que lorsqu’un visiteur, visage rougeaud et hilare, court sur pattes, écrasa l’animal d’un simple claquement de mains, des pognes larges comme des gants de base-ball. Le responsable de la com apprécia, souffla comme un sportif en fin d’épreuve, se détendit. « Désolé, je supporte pas, c’est phobique. » Le public, perplexe, le regarda, se sourit. Après un temps de silence, Martial Poupard poursuivit, comme si de rien n’était : — Un trader agit sur des positions – il prononçait à l’anglo-saxonne, exagérant son accent, ça donnait « pozicheunsss » – c’est-à-dire un ensemble d’actions identiques, une action étant un titre de propriété, O.K. ? — O.K.! scanda le chœur. — Quand il ne se passe rien, ce qui est rare, on dit que c’est la pause, l’attente, O.K. ? Attention! Ne pas confondre trader et broker; un broker, c’est… Il fit mine d’attendre une réponse de l’assistance mais comme le boute-en-train préparait une de ses sorties, Poupard enchaîna illico, sur un débit très rapide : — C’est un intermédiaire entre celui qui achète et celui qui vend, O.K. ? Tout en avançant le long des travées, il expliqua, en baissant la voix : — Un trader peut suivre les conseils d’un book, un carnet d’ordres, O.K. ? Caro trouvait que Poupard en faisait trop; il donnait l’impression de s’adresser à un public de simplets à qui il fallait inculquer précautionneusement quelques données
élémentaires. Décidément, se dit-elle, chaque milieu a son jargon ; au collège, le charabia n’était pas mal non plus, un sabir d’initiés avec ses bolosse (bouffon), swag (le style), cas soc’ (cas social), werss (univers) et compagnie. C’est alors qu’arriva, du côté des ascenseurs, un bruit confus. Manifestement cela ne figurait pas au programme. La rumeur se transforma bientôt en cri : « Occupons le marché ! Occupons le marché ! » Une demi-douzaine d’intrus envahirent l’étage, portant tous un même masque. Des clones au déguisement identique, visage blanc, oblong, dont les sourcils, les yeux, les joues, la moustache et la bouche se soulevaient d’allégresse. Même le petit trait de poils vertical au menton avait l’air de sourire. Cette fois, les traders émergèrent de leur écran, intrigués. « Occupons le marché ! Occupons le marché ! » Deux mondes se faisaient face. Quelques employés esquissèrent prudemment un sourire en direction des nouveaux venus mais la plupart manifestèrent leur impatience. « La paix! Dehors! » — Occupons le marché ! Occupons le marché ! leur répondit l’écho. Très volontaire, le responsable de la com tenta de faire front, mais il fut vite entouré, encadré par ces indésirables et il s’emporta : — Où est la sécu? Caro pensait à sa mère, dans le hall. Comment avait-elle pu, elle qui était si procédurière, laisser passer ces gens ? Ce qui semblait être le leader du groupe, un manifestant armé d’un mégaphone, interpellait le « communicant » qui lui faisait face. L’écho de sa voix envahit toute la salle. De part et d’autre, surgirent alors des noms d’oiseaux : — Bande de mafieux! — Pauvres clowns! — Fumistes! — Voleurs!
2 Caro est dans l’œil de l’ouragan, prise en sandwich entre Martial Poupard, à sa droite, et le contestataire masqué avec le porte-voix juste en face. Elle se sent comprimée, assaillie. Pas question d’arbitrer un match dont elle ne connaît pas les règles. Un moment lui vient l’idée – elle ne saurait dire pourquoi – que ces deux-là se connaissent peut-être. Ils ont l’air d’un vieux couple, liés par un long contentieux. Elle pense à ses parents… Très excité, le responsable de la communication parle, on ne sait trop à qui, dans un petit micro accroché au revers de son blaser : « C’était pas prévu, ça ! » Le chef des intrus l’entend, il tonne : — Qu’est-ce qu’il dit, lui ? Il dit quoi, lui ? Vous savez que j’en sais des choses, sur vous ? Et sur votre banque ! Ça va faire du bruit, croyez-moi! » L’attitude des envahisseurs est paradoxale : leurs gestes, leurs mots sont pleins de colère alors que leur masque n’en finit pas de sourire. Le leader – c’est un homme, à l’évidence, mais Caro devine plusieurs femmes sous les déguisements – est très remonté. Il brandit son mégaphone comme s’il s’agissait d’une arme; le « plâtreux » sent la menace et se met presque à boxer le haut-parleur. La dispute dégénère;
ça bouge dans tous les sens, les mains volent, des bras se tendent, les jambes trépignent. Des traders ont quitté leur table de travail et s’approchent, des manifestants traversent les rangées d’employés, distribuent des tracts. Il y a de l’électricité dans l’air. Le groupe des visiteurs, en retrait, est médusé, scandalisé. Pour eux, c’est comme si des hérétiques troublaient la messe, comme si des barbares agitaient des casseroles dans un concert de Mozart. Puis un nouveau brouhaha provient des ascenseurs. Débarquent les gens de la sécurité, lourds, sombres, contrariés. Ils sont d’autant plus furieux qu’ils se sont fait piéger. Caro apprendra plus tard que les manifestants sont montés directement du parking, en sous-sol, évitant la case « Accueil », et ils se sont arrangés pour bloquer de longues minutes les autres ascenseurs ainsi que les portes proches. Les intrus comprennent qu’il est plus sage de lever le camp et ils repartent, en un bloc compact, corps contre corps, épaules contre épaules, on dirait des légionnaires romains formant la tortue ; ils s’engouffrent cette fois dans la cage d’escalier qu’ils dévalent prestement, on entend décroître leurs commentaires et leurs rires. D’un grand hublot de l’étage, Caro les voit regagner le parvis, tout égrillards; ils sautillent comme des enfants quand sonne la récréation. L’homme au mégaphone tient une sorte de conférence de presse impromptue pour quelques journalistes avertis de l’opération. Le « haut-parleur » désigne, avec de grands gestes, la façade du Volcan. Il palabre, annonce d’imminentes révélations; puis tous se dispersent, sous le regard goguenard de Tom le clochard, cerbère permanent de l’entrée du centre commercial PetitPrix tout proche. 3 Tom fait ses huit heures. Il arrive à 10 h, chaque matin, devant les portes de PetitPrix, il en repart à 18 h, qu’il fasse beau, qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il canicule. Thomas, dit Tom, est aussi appelé la taupe. Plutôt rond, une tête large aux cheveux noirs hirsutes, il a toujours le même uniforme, polo rouge bedonnant – il a un faible pour la bière, Tom –, de larges shorts noirs, qui cachent mal des jambes poilues, un peu arquées, de vieilles espadrilles et un gros sac à dos toujours gonflé d’objets improbables. Difficile de dire son âge, disons la trentaine fatiguée ; il a l’air bavard mais l’air seulement. Il interpelle volontiers les passants; il attend la pièce, certes, mais surtout il espère qu’on le remarque, qu’on le regarde, qu’on le reconnaisse. Il aime par exemple qu’on lui demande comment il va, la seule question semble suffire à son bonheur : il existe alors pour les autres. Il répond systématiquement : « Tranquille, tranquille. » avec un large sourire. Au contraire il peut piquer des colères noires, non quand des passants grimacent et le trouvent repoussant, ça, il s’y est habitué, mais quand leur regard le traverse comme s’il était transparent, comme s’il n’était pas là. Alors il lui arrive de devenir agressif, verbalement bien sûr. Résultat des courses : des gens vont se plaindre
aux flics. À force, Tom connaît bien le commissariat tout proche, ses bancs, ses radiateurs, ses bureaux et ses locataires. Tom est arrivé à la Défense il y a à peu près un an en métro ; il est descendu au terminus, terminus La Défense, justement, au bout de la ligne, au bout d’une vie aussi, d’une première vie en tout cas. Il sortait de prison, dans l’est de la France, du côté de Toul, incarcéré pour petits trafics. Libéré, il se crut amnésique, il ne connaissait plus personne dans sa région. Ou bien c’était les autres qui faisaient mine de ne plus le reconnaître. Alors il fit du stop, une voiture l’amena d’une traite jusqu’au bois de Vincennes. Là, il tomba sur la première ligne de métro venue, comme par hasard la ligne numéro 1. Il enjamba les barrières et laissa la rame le conduire jusqu’à la dernière station. Ainsi il traversa tout Paris sans rien voir de la ville et il arriva directement à New York, c’est du moins l’impression qu’il eut en sortant au grand jour : «Waouuuh, New York, déjà ! » Le coin lui fit peur, une peur bleue, c’était trop; trop de tours, trop de buildings, trop de falaises vitrées, trop d’espace, trop de monde, trop de mouvements, trop de béton, trop d’esplanades. Ces gratte-ciels qui n’en finissaient pas lui donnèrent le torticolis, l’écrasèrent. Son premier réflexe fut de descendre sous le parvis, dans les sous-sols. Il passa sous la dalle, accéda à une ville commerçante qui grouillait elle aussi, descendit plus profondément, par la première ouverture qui s’offrait, et ce n’est pas ce qui manquait. Le mendiant côtoya les halls d’entrée souterrains – et luxueux – des tours voisines, c’était très chic ; il s’enfonça encore et encore, découvrit un autre monde. Il mit le temps qu’il fallait pour faire le tour du propriétaire. Car Tom est un méthodique, un maniaque. Quand il entreprend quelque chose, une exploration par exemple, il lui faut tout voir. Après une première nuit blanche, à même les marches, il parcourut, plusieurs jours durant, les dessous de la Défense. Une drôle de taupinière. Il y avait là des dizaines de tunnels, pour les voitures, les autocars, le métro, le RER, le Transilien, le tramway, sans parler des galeries techniques, des tuyauteries multiples, des gaines de câbles en tout genre. Un gruyère pas possible, un terrain de jeux formidable, des kilomètres de voies, de couloirs parallèles, dans un axe Paris/Nanterre pour dire vite, sur cinq, six niveaux et des corridors plus modestes qui reliaient entre eux tous ces passages. Même les pros de la sécurité se perdaient un peu dans ces lieux oubliés, qu’aucun expert n’avait jamais totalement inventoriés. La taupe pouvait se vanter d’être allé partout, d’avoir tout vu, répertorié les coins les plus insolites. Coup de chance : Tom dénicha vite un ancien local technique avec de l’électricité. L’administration connaissait peut-être le coin, en tout cas elle fermait les yeux. Lui s’y installa, bricola une cuisine, récupéra plus tard un canapé, un buffet et même une radio et se fit un studio de fortune ! Seul problème : la porte ne fermait pas vraiment; il fit avec. Il découvrit aussi le peuple des abîmes, les planqués des souterrains, les paumés des profondeurs, les abonnés du terrier, les zombies des entrailles qui vivaient là en permanence, sans parler de ceux qui ne faisaient que passer. Combien étaient-ils ? Une centaine peut-être. En tout cas, il y avait du monde, c’est sûr, et ces gens s’appelaient entre eux les taupes. Taupe ? Tom n’aimait pas trop le mot;