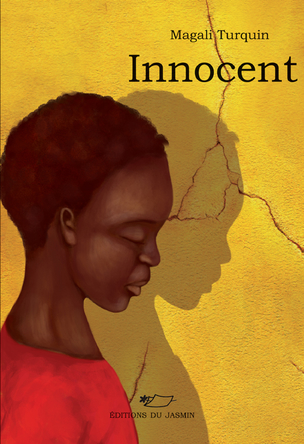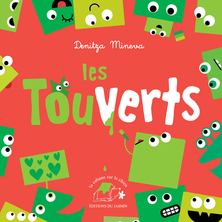Extrait du livre Innocent
Innocent de Magali Turquin et Sylvie Moreau aux éditions du Jasmin
Innocent
Courir, courir, courir. Ne plus jamais s’arrêter. Courir au-delà de l’épuisement, du dernier souffle, de l’ultime instant. Courir à en vomir. Courir pour ne pas mourir. Impression que ma tête est une peau tendue de djembé que frappent des mains inconnues. Paumes heurtant mes tempes, me forçant à fermer les paupières. Je cours, les yeux saturés de douleurs intraduisibles. Je fuis un frère, un voisin. Je fuis une ombre envahie par la haine.
Du plus lointain de mes souvenirs, je ne me rappelle pas de course plus épuisante, plus éprouvante. Même lors de la cérémonie des initiés dans la profonde forêt sacrée. Trois jours et quatre nuits sans nulle autre ressource que son courage pour affronter les adversaires. Les esprits. Les doutes. Trois jours de combat. Quatre nuits d’errance. Trois jours pour passer la frontière de l’enfance à l’âge adulte. Quatre nuits d’apprentissage. À treize ans, je suis devenu un homme. J’en porte la carrure. J’en garde les blessures. Scarification physique. Sacrifice symbolique. Dans le village, tous les hommes de mon âge, Hutus comme Tutsis, ont traversé ensemble cette transformation, solitaires dans l’ignorance, solidaires dans la puissance. C’était hier et c’est si vieux maintenant. Cela fait désormais partie d’un autre monde. Peut-être n’était-ce même pas moi qui participais à cette épreuve. Peut-être n’ai-je fait que rêver cette harmonie sans cris. Que reste-il de ce passé ? Qui reste-il non trépassé ? Et dire que le rite devait nous aider à surmonter toutes nos craintes, à participer à l’équilibre de notre société. Comprendre le monde que nous observions désormais d’un regard neuf. Et dire qu’à cette époque nous croyions tous en l’être humain. Nous avions confiance. Dire que j’ai cru, que tout le monde a cru en l’umufumu du village, homme si respectable. Lui, à qui nous confiions nos nouveau-nés et nos ancêtres. Lui, que nous ne manquions jamais de saluer et qui ne passait pas un dimanche sans être invité dans une famille ou dans une autre. Lui, que nous respections autant que notre père, à qui nous racontions nos
querelles et nos espoirs. C’était notre grand frère de respect. Et c’est lui le premier qui a dénoncé les familles tutsies à ces interahamwe pleins de fureur. Lui, le premier à avoir eu peur de la mort, peur des autres. Par sa lâcheté et son égoïsme, il a rompu ce fil invisible qui nous reliait tous. Qu’avait-il donc à se reprocher ? Sa seule identité d’Hutu respectable lui assurait déjà la vie sauve. Je le revois encore, donner des bidons d’urwagwa et tenter de dissimuler ses tremblements de frayeur. J’entends encore son rire fourbe, ses paroles fausses désormais gravées au plus profond de ma mémoire dilatée. Son regard accusateur, dénonciateur, annonceur de mort prochaine. Son rang au sein du village lui a permis de ne tuer personne de ses propres mains. Le sang a pourtant coulé en abondance par ses paroles. Ce sang mêlé de larmes d’incompréhension. Lui a préféré proférer les assassinats. Il savait parler. Il était sagement écouté. Je le revois encore dans son éternelle tenue grise, la poitrine supportant de nombreux colliers mystérieux, levant les deux bras au ciel pour montrer toute sa puissance et sa proximité avec Dieu. Si j’avais su, si j’avais imaginé que ces massacres puissent nous arriver un jour… Mon esprit ne doit pas s’attarder. Je ne peux plus revenir en arrière. Il est trop tard maintenant. Tout n’est que feu, sang et flammes. Fleurs de vie fanées. Enfer blanc. Je n’ai plus le temps. Pourquoi, comment ? Un avion a chuté. Notre président tué. Comment, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L’ignorance rythme ma course. On a dit, on a dit, oh ! on a dit tant de choses, une vengeance, une provocation, une erreur, une stratégie des blancs. Je cours toujours. Je n’entends plus que mon cœur cogner la paroi de mon corps. Je
vois rouge dans cette nuit sans fin. Est-ce mon propre sang ? Celui de maman ? De mes frères et sœurs, de mon père ? De nos vaches ? De la maison ? Il y en a tellement autour de moi et je suis seul avec ma peur. L’odeur de la mort imprimée jusque dans mes souvenirs qui se confondent maintenant avec le présent. Notre président hutu tué et le sang a giclé et le mauvais alcool a coulé. Et la mort, rapidement, s’est parée de ses plus beaux habits. Elle a mis ses bijoux et son rouge à lèvres. Elle n’a pas eu à charmer longtemps les hommes simples et modestes qui attendaient le signal. Les hommes fous, les hommes apeurés, les hommes frustrés, les hommes pleins d’intérêts… Des Hutus, qui peut-être, cherchaient à prendre leur revanche sur les années passées pendant lesquelles le pays était gouverné par un roi tutsi. Des années pourtant calmes… Le lac Cyohoha regorge de corps massacrés, boursouflés, déchiquetés. Longtemps, très longtemps, j’ai longé cette étendue d’eau sans savoir où aller. Il fallait que je reste proche de cette ressource naturelle. Je ne tenais pas à mourir de soif. J’ai bu comme j’ai pu. Je n’avais pas le choix. Des eaux malades et stagnantes. J’ai vu des choses flotter. Je crois que c’étaient des morceaux humains. Je n’ai pas cherché à regarder mais il y en avait tant et tant que j’étais obligé de les croiser. Est-ce que tous les Tutsis allaient finir comme ça ? Il en restait, des Tutsis puisque chaque jour le fleuve rougissait davantage. Du sang neuf, encore chaud, mélangé aux dernières larmes versées. Les Hutus allaient, venaient, étaient partout. Et le sang a giclé de nos artères jusqu’au cœur de la terre fertile. Notre terre rwandaise, si docile, entre les mains hutues.
Pourquoi, comment ? Je ne sais pas. Eux étaient faits pour la terre et nous pour l’élevage. Complémentaires. Nous avions le même Dieu pour accueillir nos prières, la même terre pour nous nourrir, le même ciel, la même langue, la même histoire, la même couleur, les mêmes envies, le même amour, les mêmes rires. Et malgré toutes nos ressemblances, quelqu’un, un étranger blanc, a apporté la haine entre nous. Par une différence invisible à nos yeux, il a installé entre nous cette haine tenace et destructrice. Une haine gravée désormais sur notre carte d’identité : Hutu ou Tutsi. Lui a réussi à introduire la mort, l’anéantissement. Il doit être content maintenant ! Nous, les Tutsis, nous admirions les Hutus pour cette harmonie secrète avec la terre. Harmonie et savoir faire qui nous étaient refusés. Nous, nous comprenions mieux le bétail. C’est ainsi. Mais nous étions respectueux les uns des autres. Nos vaches avaient besoin de la terre comme nous avions besoin des Hutus. Le sang n’a plus le temps de coaguler sur les machettes aiguisées. Tout ce sang mêlé de pierres et de pleurs. Et tous ces morts autour de moi. Pourquoi ? Personne n’en sait rien. Personne ne pouvait m’en parler. Et qui reste-t-il maintenant pour vouloir le faire ? Tout le monde est mort. Il ne reste que des fantômes, des ombres. Des riens de vie. Il faut que tout cela s’arrête. Je ne sais pas depuis combien de temps je fuis, traqué comme une bête sauvage. Ma gorge brûle, mes pieds sont pleins d’épines. Et je vais bientôt devenir fou, je le sens. Je suis
trop fatigué pour réfléchir. Je laisse le corps des avoisinants pourrir autour de moi sans le moindre sentiment. Sans une seule prière, un semblant d’enterrement. Je cours sans savoir pourquoi, comment, avec qui. Je cours par instinct de survie. Je ne sais plus à quoi cela peut me servir et si ça a eu un sens, un jour. Mes jambes continuent leur mouvement mécanique. Je n’étais pourtant pas seul à Nyamata. Nous étions des milliers, je crois. Mon père en tête. Toujours. C’est lui qui a pris l’initiative de quitter les maisons du village où nous n’étions plus en sécurité. Lui encore qui a décidé de partir se réfugier dans les collines, ces hauteurs touffues et surplombant le bourg qui deviendraient, par le courage de quelques Tutsis, les collines de la résistance. Elles sont ainsi désignées, maintenant, en mémoire de nos morts. J’y étais. Et j’ai vu. Et je sais pourquoi elles portent ce nom. D’autres s’en souviennent encore aujourd’hui. Même si les nouvelles générations en parlent de loin en loin. Comme une légende. Les vieux pas si vieux, mais vieillis de souffrances, racontent peut-être encore nos histoires. Des rumeurs pour certains. Moi, je sais ce que j’ai vécu, même si je ne peux pas le raconter, même s’il n’y a personne pour m’écouter. Je me chuchote à moi-même mais je parle quand même. Je murmure dans ma tête. À quoi bon crier ? Mes oreilles ne le supporteraient pas. Ma parole est un silence pour les autres. Je suis un mort qui ne peut raconter que le flou, la folie, l’indicible, l’impossible à croire, à entendre. Dire ne suffira jamais pour exprimer mon vécu. Les autres préfèrent éteindre les écouteurs. Boucler le cœur à double tour et affirmer que mes propos sont un peu exagérés, démesurés. Je n’ai
pas de recul. Trop de haine et de douleur pour être objectif. Ce n’est pas humain. Ça ne se peut pas. Et c’est bien le pire. Le pire. C’est quoi ? C’est d’être là, face à mon gouffre de souffrance et de solitude et de penser que ce sont des personnes comme moi qui ont commis ces horreurs. Comme moi. Ça aurait pu être moi. Parce que je suis humain. Parce que les personnes qui ont frappé avec leurs machettes étaient des humains, des pères, des fils, des maris… Mon père, Jean-Baptiste, sentait qu’il fallait fuir Nyamata. Beaucoup ne l’ont pas cru. Ils ont préféré se réfugier entre les bras de Dieu, au sein de Son église. Il ne pouvait rien leur arriver. Pas dans l’église. Tout le monde respecte la force divine. Tout le monde. Tous les morts y ont cru jusqu’à la première grenade jetée dans les entrailles de l’édifice. Jean-Baptiste s’est fait traiter d’infidèle. Le Ciel se chargerait de le punir. Lui et toute sa famille. Les accusateurs ont presque eu raison. Sauf que je suis là aujourd’hui, avec ma survie bancale. Que je suis là, solitaire parmi la foule, que je souffre et respire et que je pense à tous ces morts qui avaient placé la protection divine au-dessus de la folie humaine. Est-ce que le Christ pense à eux, eux qui ont été massacrés dans Sa maison ? Jean-Baptiste n’a écouté que son instinct. Il savait que n’importe quel dieu, n’importe quel diable ne pourrait plus faire reculer ces assoiffés de sang et de vengeance dont nous ignorions tout. Je me souviens bien de la longue discussion tenue à voix basse dans la cour de la plus grosse maison du village. Toutes les personnes influentes s’étaient réunies pour convenir des décisions à prendre. Toutes sentaient que cette fois-ci, si les Tutsis étaient encore la cible d’extrémistes hutus,
rien ne se passerait plus comme avant. Les insultes et les regards étaient bien plus durs, les sourires mauvais. Certains Hutus, assurés de leur suprématie, avaient même osé s’aventurer dans la maison de leur future victime pour évaluer ce qu’ils viendraient récupérer plus tard. D’autres ne se cachaient plus pour regarder nos femmes avec une insistance qui ne présageait rien de bon. Dans le village, toute activité avait cessé. Pas un grain de sorgho n’était pilé. Le bois ne crépitait plus sous les flammes. Personne ne pensait à préparer le repas du soir. Le regard accroché au visage tendu de leur mère, même les plus petits enfants s’étaient tus. Nos vaches continuaient de brouter l’herbe rare et sèche, indifférentes à notre sort. Je me souviens que nous étions tous serrés les uns contre les autres pour essayer de calmer nos tremblements. La peur nous tenait tous. Nous attendions les décisions. Nous entendions les murmures échangés. La tension montait en chacun de nous et bientôt, nous ne percevions plus que les pattes de poules qui creusaient la terre. Attente insupportable. Puis le vent s’est levé. Le bruissement des feuilles enveloppait les discussions d’un écho surnaturel. Je me souviens du visage paternel, au petit matin. Ma sœur dormait sur mes genoux et je n’ai pas pu me lever pour savoir ce qui nous attendait. Aujourd’hui, quand je repense à mon père, c’est ce visage qui me revient, dur, déterminé et consterné. Il savait qu’il n’avait pas réussi à convaincre tout le monde. Rapidement, deux groupes se sont formés. Une cinquantaine de per-