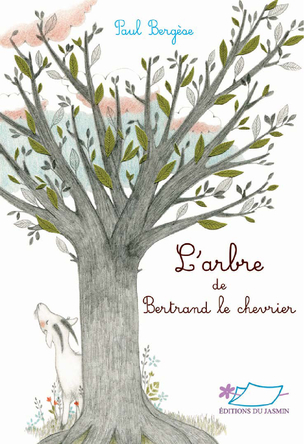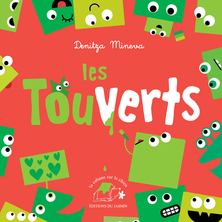Extrait du livre L'arbre de Bertrand le chevrier
L'arbre de Bertrand le chevrier de Paul Bergèse et Baptistine Mésange aux éditions du Jasmin
L'arbre de Bertrand le chevrier
Il est des histoires qui ne peuvent pas être vraies. Et pourtant elles sont belles. « Ce n’est pas possible » dit la tête. Des histoires extraordinaires, bizarres, vraiment impossibles, que quelqu’un vous raconte et malgré votre défiance, vous avez fortement envie de connaître la suite. La tête répète « ce n’est pas possible… pas possible », mais vous ne cessez pas d’écouter. Votre oreille est plus attentive. Et puis, vous observez le conteur et essayez de savoir s’il croit à ce qu’il dit… « Oui, c’est beau, mais ce n’est pas possible » et l’oreille et la tête toujours écoutent. L’imaginaire se met en marche. Le rêve avance et puis, à force : « et si… et si cela se pouvait ? » Et puis l’histoire poursuit son bonhomme de chemin, vous trotte à petits pas dans les chemins tortueux du cerveau, sans brusquerie, en douceur, s’insinue, s’incruste et laisse sa trace comme la goutte d’eau dépose son calcaire aux orgues de la grotte. Et aujourd’hui…
C’est une affaire qui remonte à très longtemps. J’étais encore jeune. Peut-être une douzaine d’années. C’est depuis cette rencontre que j’ai appris à voir, regarder et écouter les arbres autrement. Pendant les grands mois d’été, je passais les vacances dans un petit village, à la campagne, chez des amis de mes parents. Un village perché au sommet d’une colline comme on en voit souvent en haute Provence. En équilibre sur l’arête, entre Durance et Lauzon, il surveille paisiblement ses plantations d’oliviers, ses carrés de luzerne et ses quelques pièces de blé. J’aimais user mes espadrilles en découvrant les lieux par les petits sentiers pierreux et poussiéreux qui étendaient leur toile tout autour, un peu comme si le village avait lancé un filet de pêche pour bien retenir ses terres.
Ce jour-là, c’était un beau jour gonflé de franc soleil, j’avançais soulevant des vagues de jeunes criquets aux ailes rouges et bleues et des tourbillons d’odeurs d’herbes sèches, de thym et de sauge. Des vols de petits papillons aux ailes fleur de romarin m’accompagnaient. Je connaissais cette draille pour l’avoir déjà empruntée plusieurs fois. Elle menait à un petit val qui avait dû être verdoyant dans sa jeunesse. Un pont de pierres, sans doute romain, enjambait une légère dépression qui pouvait ressembler au lit d’un ancien torrent. Sous la chênaie d’yeuses, il restait par-ci par-là quelques tout petits creux herbeux envahis de galets gris et roses. Les chênes suivaient le sentier et comme lui montaient lentement le long de l’autre versant. C’est là, en arrivant sur un semblant de plateau couvert d’une petite herbe parsemée de genévriers, que j’entendis la sonnaille enrouée d’un vieux bouc. Il était vêtu d’une magnifique houppelande grise, tachée sur le flan par une fine nappe blanche. Quelques brindilles sèches s’y accrochaient. Ses cornes, fièrement portées, n’étaient que douceurs de courbes. Ses yeux d’or, fendus d’un trait de nuit, marquaient la surprise. Il se tenait sur le bord du chemin. Les chèvres qui l’accompagnaient grignotaient alentour arbustes et herbes rases, ignorant ma présence. Je m’avançai. Le bouc s’écarta un peu plus, me laissant un large passage.