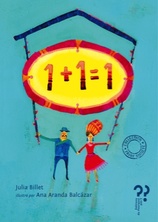Extrait du livre Les amoureux de Houri-Kouri
Les amoureux de houri-kouri écrit par Nathalie Clément et illustré par Yves-Marie Clément Aux éditions Du Pourquoi Pas.
Nourh Il y a 300 000 ans… Nourh avait quitté la Hutte-des-Femmes depuis trois jours et trois nuits pour sa première chasse en solitaire. Le crâne rasé, le visage et les épaules peints, le corps nu, elle s’était enfoncée dans la jungle, armée seulement d’un épieu. Pour devenir une femme, elle devait réussir cette dernière épreuve : rapporter à la hutte un animal tué de ses propres mains. Mais tout ce temps, elle avait joué de malchance. Les Forces invisibles du Ciel, de la Terre et des Rivières l’avaient abandonnée. On aurait dit que pour rendre son initiation encore plus ardue, les animaux avaient déserté la Montagne-des-Singes. Nourh avait faim. Elle se dirigea vers une termitière, en frappa le dôme d’un coup d’épieu bien placé. Puis elle saisit l’une après l’autre les larves blanches pour les avaler. L’estomac plein, elle leva la tête, plissa les paupières. Les oiseaux aussi avaient quitté le ciel, abandonné leurs nids. Les chauves-souris géantes et les singes, habitants des cimes, ne se disputaient plus les fruits rouges des grands arbres. La jungle était comme morte. Et, çà et là, des odeurs pestilentielles montaient du sol. Le temps de l’épreuve était maintenant écoulé : trois jours et trois nuits. Et notre Ancêtre rentrait bredouille. Plus elle approchait de la hutte, plus un sentiment de honte la submergeait.
Elle était dans ses pensées quand son œil aguerri discerna dans un tapis de fougères la queue d’un serpent disparaissant sous une souche. C’était un animal de belle taille. Le cœur de la jeune chasseuse cogna fort. Sa gorge se serra. Sa main trembla légèrement et ses doigts se crispèrent sur son arme. Elle rapporterait ce trophée au clan. Elle s’agenouilla sur le lit de feuilles mortes et plongea son épieu à l’endroit même où s’était lové le python. Elle enfonça à plusieurs reprises la pointe de son arme dans le flanc du serpent pour le forcer à sortir de son trou. Très vite, elle entendit son souffle rauque et sentit au bout du bâton les contractions puissantes de ses muscles. Il ne pourrait lui échapper. Nourh frissonna. Le corps de l’animal se déroulait sous la violence des coups. La tête ovoïde apparut soudain en pleine lumière. La langue bifide dardait dans la direction de notre Ancêtre. Le serpent ouvrit une gueule gigantesque, menaçant de mordre. Nourh se releva, reculant d’un bond. Elle attendit que le serpent fût entièrement sorti de sa tanière pour l’assommer d’un coup. Elle observa le corps secoué de spasmes irrépressibles. La gueule ouverte, la langue dehors, les dents écumantes de sang, le serpent était mort. Mais des soubresauts nerveux l’agitaient encore. Nourh bomba le torse et se frappa la poitrine dans un bruit de tambour. Elle avait vaincu Bida, le serpent malin. Elle allait revenir au campement. Elle déposerait sa proie à l’entrée de la hutte. Elle enjamberait le corps sans vie de l’animal et pénétrerait dans la grande case ronde puis se dirigerait fièrement vers Oulm-la-Vieille, sa grand-mère. Celle-ci apposerait les mains sur sa tête, lui accordant le droit de laisser à nouveau pousser ses cheveux, le droit de prendre un homme. Aya Je m’appelle Juliette Aya Ahoutou. Tout le monde m’appelle Aya. Je suis baoulée, j’ai 28 ans. Je suis née un vendredi à la clinique Sainte-Fraternité de Bouaké, Côte d’Ivoire. Je suis allée à l’école de la Pépinière des Deux Plateaux, Abidjan, puis au lycée International Jean Mermoz. J’étais « une élève brillante, espiègle, mais brillante », disaient mes professeurs. Et c’est comme ça que j’ai obtenu une bourse pour aller étudier l’archéologie en France. Le chauffeur me hurle dans les oreilles : — Café Arc-en-Ciel, madame ! Je règle ma course, ouvre la portière. Je sors du taxi collectif. Une moto s’arrête à ma hauteur, soulevant un nuage de poussière. Le passager distribue des flyers. J’en prends un sans réfléchir : « Lait blanchissant d’Abidjan, la peau claire sans cicatrices », avec la photo d’une jeune et belle Africaine plus blanche que blanche disant : « Moi, j’aime le teint clair ». Une folie, des produits hyper-nocifs pour la peau. Mais depuis que les crèmes pour dépigmenter sont interdites par le gouvernement, il paraît que les ventes se sont envolées. « Moi, je suis noire et fière de ma couleur». Cela pourrait être ma devise ! En tout cas, c’est ma marque de fabrique et toute mon histoire, et je la revendique.
Je traverse la gare routière. Il fait bon ce matin de décembre. Le ciel est dégagé. C’est toujours comme ça au début de la saison sèche. Je me rends dans une agence de Bouaké pour voir les annonces d’embauche. Je viens de terminer en France mon doctorat « Archéologie en Préhistoire » et cela fait à peine une semaine que je suis rentrée au pays. De Paris, j’ai postulé pour une place d’enseignante à l’université Alassane Ouattara, dans les lycées de la ville, à l’Institut d’Histoire, d’Art et d’Archéologie d’Abidjan, à l’université de Yamoussoukro. Visiblement, une chercheuse de vieux os, ça n’intéresse pas grand monde dans le secteur. Si ça continue, je finirai comme beaucoup de mes consœurs par décrocher un petit boulot juste pour survivre… Mais non, je suis revenue pour que les sacrifices de mon père et de ma mère soient récompensés et que mes parents soient fiers de moi. Mon téléphone vibre. Je ne vois pas grand-chose sur mon écran à cause du soleil. Je m’abrite sous l’auvent de la librairie Sodiya… C’est un mail du professeur Cartier, le chercheur qui m’a poussée à présenter ma thèse. « Chère Aya, Je me permets de vous contacter au sujet d’un projet de fouilles auquel mon équipe et moi-même aimerions vous associer. Mais d’abord les faits : il y a quatre mois, près des monts Houri-Kouri, au sud du Mali, Célestin Cidibé, un jeune journaliste du village voisin, a trouvé dans une grotte des ossements en très bon état de conservation ainsi qu’un silex taillé, vestiges sans doute mis à jour par des hyènes ou des chiens sauvages. Ce jeune homme très avisé a réalisé quelques photos et prévenu le ministère de la Culture à Bamako. J’ai moi-même été rapidement averti par un collègue malien qui m’a transféré les photos. Les ossements sont peut-être d’origine humaine. D’après l’aspect de la pierre taillée, il y a de fortes chances pour que cette station ait été occupée par des hommes du Paléolithique. Cela fait quelques années que je projette de revenir au Mali pour réaliser des fouilles dans cette région, vous le savez. Je me suis donc rapidement positionné pour organiser une mission en coopération avec le ministère malien. Chère Aya, pour ma part, j’ai le sentiment qu’il s’agit là d’une découverte sans précédent, qui nous permettra peut-être d’apporter notre pierre à l’étude de la colonisation de l’Afrique de l’Ouest par les premiers hommes. Voilà plus de trois mois que je travaille sur ce dossier et mon équipe est enfin réunie. Nous devrions arriver sur le site au début du mois prochain. Il ne manque plus que vous. Comme dirait « l’agent M » à James Bond, « Si vous acceptez la mission, rendez-vous à Houri-Kouri ! ». J’utilise le ton de la plaisanterie mais évidemment, vous n’êtes pas sans savoir que cette région du désert de Gourma est une zone de conflits dangereuse. Aussi je vous laisse réfléchir à ma proposition, sachant qu’une fois sur place, nous serons bien sûr protégés. Appelez-moi pour en discuter… » Une mission au Mali… ma première mission ! C’est un truc de OUF ! Mon cœur vacille. Je fais demi-tour pour rentrer à la pension « le Cauri d’Or » où j’ai loué un modeste studio le temps de prendre mes marques. Je regarde par la fenêtre. Ma ville, immense, tentaculaire, bruyante et sale. Les klaxons, les motos, les fumées qui s’élèvent. Les cris. Le grand marché. Je pourrais quitter Bouaké. Demain peut-être. Prendre les routes du nord. Traverser la frontière et rejoindre le site. Et alors, pour quoi faire ? Le professeur Cartier, qu’attend-il de moi ? Après l’effervescence, les questions commencent à surgir.
C’est vrai que sur le coup, je n’ai pas mesuré le danger de me rendre au Mali, dans ce pays aux mains de bandes de terroristes et de mercenaires, dans cette région dévastée par la guerre. Je regarde l’heure sur mon portable. Il est 10 heures 20, une heure de moins qu’en France. Je peux sans doute joindre le professeur à son bureau. Les doigts tremblants, j’appelle le Muséum d’Histoire naturelle de Paris. — Ma petite Aya, je savais que vous seriez réactive. Alors, ce retour au pays, un choc ? — Surtout pour la température. — Oh, ici à Paris, c’est en chute libre. Bon, et plus sérieusement, votre sac est prêt ? — Je n’ai pas encore pris de décision, professeur. Je suis hésitante. Vous comprenez ? Je viens à peine de soutenir ma thèse et… je manque peut-être d’expérience pour... — Non, non, vous êtes tout à fait capable de participer à cette mission, Aya. Je vous ai vue à l’œuvre sur le terrain et vous avez toutes les qualités requises, et l’esprit de groupe. C’est très important, ça ! Notre équipe est composée de chercheurs absolument formidables, vous savez. Nous avons recruté plusieurs étudiants de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Aya, c’est une grande Aventure. Avec un grand « A ». De plus, bonne nouvelle, le matériel a débarqué la semaine dernière à Bamako et je viens d’apprendre que les caisses étaient en route pour Houri-Kouri. Elles seront prochainement acheminées sur le site. Je regarde le plafond. Le ventilateur tourne au ralenti, brassant l’air qui peine à circuler. Je pense aux chercheurs qui m’ont fait rêver quand j’étais étudiante, Mary Leakey, Jean-Jacques Hublin, Abdelouahed Ben-Ncer et tant d’autres. Mes cours d’archéologie en Préhistoire me reviennent en boucle. Et si mon tour était arrivé de participer à une telle aventure ? Faire une découverte sans précédent… Je n’y crois pas ! Après tout, il s’agit peut-être de la chance de ma vie. Notre conversation continue un petit moment. Le professeur utilise les bons arguments. Ceux-là mêmes qu’il utilisait pour m’encourager quand j’étais encore son étudiante. Je suis décidée, je vais préparer mon voyage. Dans la soirée, il me rappelle pour m’annoncer que tout se présente bien. Je suis attendue à l’unique hôtel de Houri-Kouri ! Et un chauffeur m’amènera sur le site pour rejoindre l’équipe. Plus de doute et plus d’hésitation. L’aventure m’appelle.
Oscar Je m’appelle Oscar Bonogo, je suis mossi. Je ne connais pas mon âge car je ne possède pas de papiers indiquant l’année de ma naissance. L’histoire raconte que je suis né il y a longtemps au Burkina Faso, quand ce pays s’appelait encore la Haute-Volta et son président Aboubakar Sangoulé Lamizana. J’ai quitté le ventre de ma mère au beau milieu de la brousse, entre les villages de Douia et Zabré. Ce matin-là, ma mère gardait nos bêtes près du puits. Les seuls témoins de ma venue au monde furent deux chèvres, un baobab et un vieil acacia desséché aux épines couvertes de poussière. Depuis ce temps mon ami, j’habite toujours ici. Souvent dans ma longue vie, je me suis dit que je n’avais pas eu la chance de naître au bon endroit. J’ai toujours vécu dans la misère alors que d’autres dans ce monde se goinfrent comme des criquets dans les champs de maïs. Tu te dis que j’aurais pu voyager, aller tenter ma chance en ville ou dans un autre pays ? Non. Chez nous, c’est comme ça. Tu es attaché à la terre. Tu y nais, tu y vis, tu y meurs. L’ailleurs nous fait peur. Bien sûr, tu peux te rendre à Ouaga ou à Bobo pour des affaires ou pour régler des problèmes administratifs. Mais il ne faut pas trop tarder à revenir au village. Je dis ça, mais ce n’est plus trop valable pour la jeune génération qui ne respecte plus les traditions. Eux n’hésitent pas à quitter le pays. Ils prennent l’avion pour aller s’installer ailleurs. Les plus miséreux bravent le désert à pied pour se rendre au Maroc, en Algérie ou en Europe. Là où il y a du travail. Mais ils sont souvent expulsés. On leur vole tout: leurs vêtements, le peu d’argent qu’ils ont gagné. Et on les renvoie à la frontière ! Moi, je dis : s’ils partent là-bas, c’est parce qu’ils n’ont pas le choix ! Début avril, cette année, l’État diffusait en permanence ce nouveau slogan à la radio et à la télé : « Nous devons améliorer la sécurité alimentaire et économique des familles par le développement durable de l’élevage de poules et de chèvres. » On se disait entre nous : « développement durable », c’est une expression inventée par les Blancs. Méfiance ! Personnellement, j’ai mis un moment à comprendre ce que cela voulait dire. Au village, nous nous sommes réunis. Et à force d’en discuter, on a fini par y croire. Des chèvres et des poules, ce n’était peut-être pas une mauvaise idée. On se disait qu’on allait enfin sortir de notre misère millénaire. En mai, à l’issue de la dernière réunion du conseil villageois de développement, nous avons décidé que c’était mon tour de récupérer l’argent de la tontine : une belle somme épargnée pendant des mois par les familles. Je pourrais acheter des poules comme mon voisin Anselme-Honoré. Lui, il s’en était payé quinze. J’ai bien réfléchi. J’ai réfléchi des heures. Puis j’en ai discuté longuement avec mon épouse. Puis avec mon oncle maternel qui est de bon conseil. Des poules ? Des chèvres ? Le choix n’était pas si facile !
Mon ami, je te livre ici ma réflexion de l’époque: les chèvres ont un meilleur rapport que les poules. Bien sûr, les poules pondent des œufs et font des poussins que l’on peut faire grandir et vendre sur les marchés. Mais elles sont plutôt bêtes et on les retrouve souvent écrasées au bord de la piste. Parfois aussi, elles finissent en sauce arachide dans la marmite de votre voisin. En plus, elles attrapent facilement des maladies. Les chèvres donnent du lait en abondance, et les chevreaux se vendent à très bon prix. Et il s’avère qu’elles ne sont pas trop délicates ni difficiles à nourrir. Au village, nous n’avons pas de bouc, mais une cousine de mon épouse connaît un paysan peul qui lui a assuré qu’il me prêterait volontiers le sien pour des saillies en échange d’un chevreau par an. Enfin, posséder des chèvres est bien plus prestigieux que posséder de la volaille. Tu comprends bien cela, mon ami ? Paix à ton âme. C’est ainsi que mon choix s’est porté sur des chèvres du Sahel. Avec mon épouse, nous avons étalé l’argent de la tontine sur la table. J’ai refait mes calculs. Je devais aussi garder quelques milliers de francs au cas où, car il faut toujours être prudent. Au bout du compte, je pourrais m’acheter trois têtes. Kim Je m’appelle Kim, je suis dogon. À ce jour, j’ai douze ans. Ma mère m’a mise au monde devant le stade Modibo Keita, quartier de Missira, Bamako, Mali. Autant dire dans l’un des coins les plus pourris du monde. Elle m’a élevée tant bien que mal, ballotée sur son dos, jusqu’au jour où, lassée, elle m’a abandonnée. Là, posée à même le sol, dans un boubou miteux. Et puis elle a disparu. Je ne sais pas trop comment. Je suis bien incapable aujourd’hui de dire à quoi elle ressemblait ! Une vieille bonne sœur m’a ramassée. Elle s’appelait sœur Marie du Carmel. On l’appelait aussi « Mère Supérieure ». J’ai vécu le début de mon existence dans son orphelinat. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque là. C’est comme une sorte de rêve où les choses se répètent. Se lever, se laver, s’habiller, manger, dormir. Écouter la messe et les prières aussi. Un jour, la mère supérieure est morte dans son lit. Ça ne m’a pas fait bizarre. On est passés la voir l’un après l’autre en présence du prêtre. On devait lui baiser la main. C’était comme si elle était encore vivante. Comme si elle dormait. Sauf que quelqu’un lui avait noué un bout de tissu autour de la tête pour que sa bouche reste fermée
Oui, c’est ça. On aurait dit qu’elle dormait. Je me souviens surtout des mouches qui tournaient autour de son visage et qui essayaient de se poser au creux de ses yeux, au bord de ses narines. Le prêtre, machinalement, balayait l’air de la main puis se remettait en prière. Après, on nous a rassemblés dans le réfectoire. Des gens des beaux quartiers sont entrés. Des hommes. Un monsieur avec une cravate et des lunettes de soleil avait l’air d’être le patron. Il sentait bon le parfum. Et ils ont discuté. On ne se doutait pas de ce qui allait se tramer. La semaine suivante, ces profiteurs se sont emparés du peu de biens que la vieille bonne sœur possédait. Ils ont vendu l’orphelinat et on m’a mise à la porte avec les autres pensionnaires. Moi, je suis assez grande pour me débrouiller dans la vie, alors je me suis mise à voler sur les marchés histoire d’avoir de quoi me mettre sous la dent. Je me suis vite enrôlée dans une bande. À plusieurs, on est plus fort ! On était une dizaine au début, très organisés : notre chef s’appelle Walid, surnommé « le Lion ». À ce moment-là de mon histoire, c’est un grand gars de quatorze ans, tout maigre avec une épaule plus haute que l’autre, des taches blanches sur le visage. Il lui manque les dents de devant à cause des bagarres. Il porte toujours un tee-shirt kaki de l’armée régulière. Il me prend sous son aile et m’appelle « petite sœur ». Avec lui je me sens protégée. Notre mode de fonctionnement est simple : vous avez déjà vu des vautours qui tournent dans le ciel au petit matin et tombent d’un seul coup sur les tas de poubelles ? On arrivait comme eux sur un étal. On se remplissait la bouche et les poches puis on détalait comme des gazelles. Parfois, l’un d’entre nous se faisait attraper par la police. Il prenait une danse et on le retrouvait le soir la tête toute amochée dans un quartier délabré de la ville. Un jour, je me suis fait choper par une marchande plus rapide que les autres. Elle a commencé par me chicoter avec un bâton. Après, elle m’a obligée à bouffer un rat crevé qui traînait par terre pas très loin de son étal. Des hommes et des femmes qui passaient rigolaient. Je crois que ça a été ma pire expérience de voleuse sur les marchés de Bamako. La police m’a embarquée. Walid-le-Lion a eu le temps de me dire : — T’inquiète, petite sœur, je ne t’abandonnerai jamais ! Et c’est à peu près à cette époque-là que je suis devenue soldat.
Ce matin du mois de juin, je suis rentré tout fier dans l’enclos avec mes bêtes. Mais hélas, c’est là que mon malheur a commencé. Car je n’avais pas prévu cette satanée sécheresse qui s’est abattue sur notre région tel un fléau de Dieu. Tu sais mon ami, la sécheresse, c’est ce que je déteste le plus. C’est pour ainsi dire effrayant. Les sources, les rivières et les lacs sont à sec. Les puits ne donnent plus d’eau ou alors une eau boueuse et pestilentielle où grouillent plein de bestioles, et dont il faut malgré tout se contenter. Et les vieux meurent de chaleur dans leur sommeil. En octobre, on ne trouvait plus une goutte d’eau. Les poules de mon voisin Anselme-Honoré sont mortes l’une après l’autre, le gosier plus sec qu’un caillou chauffé à blanc par le soleil. L’homme le plus riche du village voisin possédait un bœuf. Ce dernier n’a pas survécu non plus. En novembre, j’ai perdu deux chèvres dans la même journée. Un lundi, je me souviens. Mon épouse a fait bouillir la marmite et a cuisiné un ragoût avec des gombos et de beaux morceaux d’igname. On a régalé le conseil villageois avec. Mais les chèvres étaient si maigres qu’on a passé le repas à sucer des os. Entre nous, mon ami, on ne peut pas faire plus confiance à une chèvre qu’à une poule ! C’est ce que j’ai dit le lendemain au formateur du ministère qui passait dans les villages pour vérifier l’état des cheptels. Je lui ai demandé si dans son nouveau programme le gouvernement avait prévu des compensations pour les éleveurs victimes des aléas climatiques. Il ne m’a rien répondu. Parfois, je me dis que l’État se fout bien de nos malheurs et de la foudre qui s’abat sur nous, les pauvres paysans. Début décembre, un matin, au réveil, j’ai mangé un reste de mil que mon épouse avait préparé la veille et je suis sorti pour m’occuper de ma dernière chèvre. C’était une petite bête blanche avec des taches noires sur le dos. Elle portait fièrement ses cornes vers l’avant. On aurait cru qu’elle voulait en découdre chaque fois qu’on l’approchait car elle baissait la tête comme pour attaquer. Il n’en était rien car il s’agissait d’une bonne bête. Comme la chèvre de monsieur Seguin. Tu connais la chèvre de monsieur Seguin ? Il faisait encore plus chaud que d’habitude. La rivière Nazinon n’était plus qu’un lit de cailloux où même les serpents et les scorpions noirs n’osaient plus s’aventurer. Désormais, chacun me reprochait d’avoir acheté des chèvres, même l’oncle maternel qui est pourtant de bon conseil. Toute la faute me revenait. C’est une honte ! Ils n’avaient qu’à prendre l’argent de la tontine pour réaliser leurs propres projets. Tu vois, mon ami, je sentais bien que j’allais être jugé par les miens !
Nourh Notre Ancêtre chargea le serpent sur ses épaules. La tête pendait sur sa cuisse droite. De l’autre côté, la queue de l’animal touchait presque le sol. C’était une belle bête, si bien que Nourh avait du mal à marcher. Chez les chasseuses, le serpent était considéré comme une proie facile. Il suffisait d’un peu d’adresse pour l’assommer. Mais celui-ci n’était pas un serpent ordinaire. Il était presque aussi lourd que Nourh, et il aurait très bien pu esquiver son attaque, la surprendre, refermer sa mâchoire sur elle et enrouler ses anneaux autour de sa poitrine pour l’étouffer. Nourh posa la main droite sur le corps musculeux de sa proie. Oui, c’était une belle bête avec assez de chair pour nourrir toute la hutte. Elle pouvait être fière de sa capture. Soudain, le sol se mit à vibrer sous ses pieds. Nourh pensa à un groupe de phacochères. Elle se retourna, scruta les alentours,regarda en direction de la rivière Sawaba, où se trouvaient les siens. Le sol de la jungle cessa de trembler. Elle entendit les cris des enfants et des femmes qui jouaient dans l’eau à l’heure du bain. Mais quelque chose n’allait pas. L’air était plus chaud que d’habitude. Un vent épais se leva. L’odeur du soufre lui piqua les narines. Le sol vibra de nouveau. Cette fois-ci, les secousses soulevaient l’humus, les branches gémissaient, de grands arbres craquaient. Nourh prit peur, lâcha son épieu, abandonna sa proie, et se mit à courir en direction de la rivière. Le ciel au-dessus de la canopée se remplit d’éclairs avant de s’obscurcir aussi brutalement. Une série d’énormes explosions retentit. Nourh se retrouva projetée au sol par un violent souffle d’air brûlant. Sa tête heurta un rocher. Son corps roula sous le tronc d’un arbre couché. Elle s’effondra, inconsciente. La Montagne-des-Singes venait littéralement d’exploser. Son flanc crachait des flammes, une nuée ardente dévalait ses pentes abruptes dans un vacarme assourdissant. La forêt entière se souleva. Quand notre Ancêtre se réveilla, il n’y avait plus un bruit. Les arbres s’étaient tus. Elle passa les mains sur son corps nu. Il était entièrement couvert d’une fine poussière grise. Elle entrevit des plaies éparses sur sa poitrine, des brûlures sur son ventre et le haut de ses cuisses. La cendre volcaniqueavait colmaté les plaies et asséché le sang. Que s’était-il passé ? Elle se releva avec difficulté, marcha d’instinct vers la rivière pour y retrouver les siens. Mais elle ne reconnaissait plus rien. La plupart des arbres étaient couchés. Une brume chaude et jaunâtre flottait dans l’air. Difficilement, elle arriva au bord de la rivière Sawaba. Des troncs d’arbres arrachés à la rive flottaient. Mais il n’y avait plus aucune trace des siens. Elle appela. Personne ne lui répondit. Un peu plus loin, il ne restait rien de la Hutte-des- Femmes. Elle s’effondra à genoux dans la poussière grise, prit son visage entre ses mains. Un sanglot incontrôlable secoua sa gorge et laissa sortir de sa poitrine un gémissement plaintif. Elle resta ainsi un long moment, le regard brouillé par les larmes. Le soir vint. La nuit enveloppa bientôt ce qu’il restait